NOTES 2 bis
Pour imprimer
réduire à 85 %
mai
2006
économie
apparition
Le
Capital : non sens, non sens
Jorion – Le rapport entre la valeur et
le prix
Jorion –
Le mathématicien et sa magie
Et l’on tuera tous les
sunnites
Searle – Langage,
conscience, rationalité : une philosophie naturelle
Hayek – La paille et la
poutre
Aux chiottes le
structuralisme des french sixties
Holisme et
individualisme : la clarification d’une querelle
La G4G et la fin de la
globalisation
John Searle –
Langage, conscience, rationalité : une philosophie naturelle
Philosophie, science
politique et religion dans la théorie de la démocratie de Tocqueville
Polanyiyya.
La véritable invention du besoin
Conclusion pour le XXIe
siècle
La démocratie est un
conformisme
Dumont – préface à La
Grande transformation
Et maintenant un peu de
Toynbee
1989 : L’enivrement
de la victoire
Le discours de Munich du
colonel Poutine
Toynbee et le phénomène
du racisme, avec son rôle dans le ‘‘choc des civilisations’’
Fourquet :
l’économie n’existe pas
Fourquet :
le capitalisme existe-t-il ?
American parano Jean-Philippe
Immarigeon
Le texte complet du
passage de Hubert et Mauss cité par Descombes
Renaud Camus :
« les riches ne sont plus que des pauvres avec de l’argent »
L’idéologie
américaine les méfaits de l’individualisme méthodique
La stratégie médiatique
états-unienne 1945-2005
De l’ère géopolitique à
l’ère psychopolitique
Toutes
les occurrences du terme « économie » dans l’œuvre de Marx
Descombes :
« Préface » à Le Rite et la raison
Descombes :
Le Même et l’autre, extrait
Descombes :
De l’intellectuel critique à la critique intellectuelle
Descombes :
Vers une anthropologie comparative des démocraties modernes
Descombes :
« Un Itinéraire philosophique »
Turgot :
Réflexions sur la formation et la distribution des richesses – 1766
Turgot :
Valeurs et monnaies – 1769
Ian
Hacking : l’argent est une institution, l’économie n’est pas une
institution
Propos
d’un avorton virtualiste
« MANIFESTE POUR LA VRAIE
DÉMOCRATIE »
|
Il est loin (été 2002) le temps où une source à la Maison-Blanche pouvait dire avec une certitude vaniteuse à l’auteur Ron Susskind, lui donnant ainsi une définition du virtualisme : «“That’s not the way the world really works anymore,” he continued. “We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality — judiciously, as you will — we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how things will sort out. We’re history’s actors . . . and you, all of you, will be left to just study what we do.”» Certains continuent à penser comme cela mais il y a déjà beau temps que l’Histoire a pris sa revanche. S’ils veulent remettre ça avec l’Iran, d’autres sont prêts à recueillir les fruits de cette action et l’essoufflement de cette énorme et monstrueuse caricature d’Empire, de cet artefact anti-historique, pourrait alors bien ressembler, par les conséquences de l’acte au niveau intérieur washingtonien, au spasme ultime. |
|
Je lis un texte très intéressant que je commenterai plus tard, mais je relève d’abord ceci : les auteurs censés s’interroger sur la signification (le mot signification est très emmerdant car il signifie ! aussi bien « sens » que « désignation ») du mot économie, non nommés, non cités, ne sont pas très nombreux parce que, à ma connaissance, ils ne sont que deux : Fourquet et Heil Myself ! Mais là n’est pas la question. La question est que ces auteurs, non nommés, non cités, ne trouvent pas du tout judicieux de s’interroger aujourd’hui sur la signification (au sens de sens) du mot « économie » (la prétendue chose) pour la simple raison que ce mot est parfaitement défini dans les dictionnaires (depuis 1960 seulement notez bien. Avant pas de définition dans les dictionnaires mais seulement une utilisation par les spécialistes dont Weber). Les deux auteurs en question, non nommés, non cités, ne s’interrogent pas sur la signification (au sens de sens) du mot « économie », mais sur l’existence de l’objet signifié (dénoté, désigné) par ce mot(la prétendue chose). Pour ces deux auteurs, non nommés, non cités, l’objet désigné par le mot « économie » (la prétendue chose) n’est pas un objet réel (n’est pas une chose). L’objet de n’importe quelle doctrine est nécessairement « ce dont parle cette doctrine ». Oui, c’est certain, du temps des auteurs anciens, la prétendue science économique qui n’existait pas encore (encore une invention de Say) « parlait des richesses, de ce qui constitue la fortune » ; elle en parle toujours et c’est d’ailleurs cela qui est repris dans la définition des dictionnaires. Mais ce qui est nouveau c’est que la prétendue science économique parle aussi d’un objet nommé « l’économie » ; elle le fait très exactement depuis 1818, après que le crétin Say le fit pour la première fois. Évidemment Adam Smith, auteur plus ancien s’il en est, ne pouvait le faire puisque le crétin Say fut l’inventeur de cet usage. Que ce soit Fourquet ou Heil Myself, nous dénions, pour des raisons différentes (historiques et … économiques selon Fourquet, logique selon Heil Myself), toute réalité à l’objet désigné (signifié) par le mot « économie ». Autrement dit : selon ces deux auteurs, non nommés, non cités, l’objet désigné par le mot « l’économie » n’est pas un objet réel (la prétendue science économique est un objet réel, hélas). Les deux auteurs, non nommés, non cités, ne prétendent pas que l’« on ne saurait pas exactement de quoi parle la science économique », ils prétendent seulement que ceux qui prétendent savoir de quoi parle la science économique quand elle utilise le terme « l’économie » ne savent pas de quoi ils parlent : ils confondent un objet réel avec une classe de faits. C’est seulement dans ce cas que les deux auteurs, non nommés, non cités, prétendent que l’« on » (on est un cochon) ne sait pas exactement de quoi parle la science économique. Mais les deux auteurs, non nommés, non cités, prétendent chacun savoir très bien, eux, de quoi parle la science économique dans ce cas : très exactement, dans ce cas, la science économique parle d’une classe de fait. Fourquet dit littéralement : « il s’agit d’un classement ». Une propriété de la langue, néfaste pour la
fiabilité de l’action de penser, est sa propension à créer des noms propres
auxquels nul objet ne correspond. (…) Ainsi, une grande part du travail du
philosophe consiste — ou devrait du moins consister — en un combat avec la
langue. Frege. Écrits posthumes Enfin, ce n’est pas principalement les doctrines économiques et les doctes économistes qui parlent de « l’économie », mais, massivement, depuis 1960 (selon Ian Hacking), la presse, la radio, la télévision et les piliers de bistrots. Ce Jorion serait-il lui aussi un téléologue ? Quand on ne veut pas comprendre, on ne comprend pas, ce qui ne signifie pas, hélas, qu’il suffise de vouloir comprendre pour comprendre ; ce serait trop beau. Notons enfin que Fourquet a consacré vingt ans à la question, a publié un livre épais et documenté, publia une dizaine d’articles dans le revue du MAUSS depuis 1989 et que donc il est peu probable que Jorion puisse ignorer son existence. * * * Funny : dans la suite du texte Jorion cite Fourquet, mais sans aucune référence à l’irréalité de l’économie, alors que Jorion lui-même est en train d’exposer une thèse sur l’irréalité de la valeur, sur l’inexistence d’une valeur-substance (« La valeur n’est pas une substance. » Voyer, 1976). Il ne cite Fourquet que pour une remarque sur l’origine historique du concept de valeur et du double renversement d’une réalité en fiction et d’une fiction en réalité, les prix (la réalité) n’étant conçus que comme l’ombre portée par la forme platonicienne de la valeur (« La valeur comme “idée platonicienne” »). De toute façon, c’est très intéressant tout ça. Également dans La Revue du Mauss permanente (Quelle aubaine : mieux vaut une revue permanente qu’une révolution permanente. Vive Internet, vive le Département de l’Attaque (DoA) nouvelle doctrine) un alléchant article de Lordon et Orléan sur l’institutionnalisation de la monnaie, la monnaie comme institution (et la valeur comme rien du tout, ce qui recoupe l’article de Jorion). |
|
L’exercice auquel Gödel va se livrer va consister en ceci : construire un système unique se composant à la fois de l’arithmétique et du discours méta-mathématique relatif à l’arithmétique. Le moyen de le faire consiste à coder les propositions méta-mathématiques sous forme de propositions mathématiques et à effectuer ensuite sur celles-ci des opérations arithmétiques. On conçoit qu’à partir de là il devienne possible de produire en particulier une formule arithmétique telle qu’elle est à la fois, d’un côté, en tant que message codé dans une expression arithmétique, un énoncé métamathématique posant un jugement sur la démontrabilité d’une proposition, et d’un autre côté, cette proposition elle-même en qui le commentaire métamathématique a été codé. On aura obtenu ainsi, selon les termes qu’utilisera Gödel, une formule qui « dit quelque chose d’elle-même ». L’objectif est de lier indissolublement à l’intérieur d’une formule unique, une proposition arithmétique et un commentaire méta-mathématique qui s’applique à elle. Opérer un tel codage est bien entendu extrêmement difficile et la plus grande partie de la « démonstration » du théorème consistera pour son auteur à mettre en place les conditions qui autoriseront un encryptage aussi spécial. Gödel sera obligé en particulier de faire intervenir la notion de « classe récursive » qu’il traitera comme une composante légitime de l’arithmétique. Ce faisant il opère un saut que tous les mathématiciens ne sont pas prêts à faire. Daval et Guilbaud en particulier considèrent au contraire que la récursion est elle-même une notion métamathématique et non arithmétique : « S’il y a une métamathématique, elle est constamment menacée d’expropriation par la mathématique. L’induction (récurrence) est-elle autre chose qu’un constat métamathématique ? » (Daval & Guilbaud, Le Raisonnement mathématique, PUF, 1945 : 144) . Sans entrer dans les détails trop techniques, la nécessité pour Gödel de manipuler des classes récursives est due au fait que ceci lui permet de lier encore davantage les notions de démontrabilité et de vérité. On a vu qu’une proposition mathématique démontrable est vraie. La définition d’une « classe récursive » à partir d’une fonction récursive lui permet de faire un pas supplémentaire : lorsqu’une instance d’une telle classe n’est pas démontrable — lorsqu’on ne peut pas la prouver vraie — alors sa négation l’est automatiquement. Une fonction récursive permet d’engendrer des nombres en les envisageant au sein de séries. De manière banale, les nombres naturels peuvent être générés à partir du principe de consécution suivant : « un nombre est égal au nombre précédent plus un ". On produit ainsi la suite 1, 2, 3, … Deux formules seulement suffisent pour engendrer la totalité des nombres naturels : celle que je viens de dire, que j’écrirai sous forme symbolique comme an = an-1 + 1, et une forme initiale qui vaut pour le premier terme, celui qui n’a pas de « précédent » : a0 = 0. Voici un ensemble de deux formules du même type qui permettent d’engendrer la suite des carrés : an = an-1 + n + (n - 1) ; a0 = 0. On peut vérifier pour an le carré de 1 : le carré du nombre précédent est 0, auquel on ajoute n qui est ici 1 et (n - 1) qui est zéro. On a « carré de 1 » égale 0 + 1 + 0. De même pour le carré de 4, par exemple de 4 :, le carré du nombre précédent 3 est 9, auquel on ajoute 4 lui-même et (4 - 1) égale 3. Le résultat est 9 + 4 + 3 = 16. Pourquoi certains, dont Daval et Guilbaud, considèrent-ils qu’une définition récursive (également appelée par « induction complète ») est d’ordre méta-mathématique, autrement dit qu’il s’agit d’un commentaire, plutôt que d’une propriété d’ordre mathématique, et qu’elle ne peut en conséquence être considérée comme un moyen de démonstration ? La réponse fut apportée au début du XXe siècle par Henri Poincaré qui n’était pas seulement un grand mathématicien et un grand logicien, mais aussi un philosophe des sciences de premier rang. Il écrivait dans La Science et l’Hypothèse : « Le jugement sur lequel repose le raisonnement par récurrence peut être mis sous d’autres formes ; on peut dire par exemple que dans une collection infinie de nombres entiers différents, il y en a toujours un qui est plus petit que tous les autres. On pourra passer facilement d’un énoncé à l’autre et se donner ainsi l’illusion qu’on a démontré la légitimité du raisonnement par récurrence. Mais on sera toujours arrêté, on arrivera toujours à un axiome indémontrable qui ne sera au fond que la proposition à démontrer traduite dans un autre langage. On ne peut donc se soustraire à cette conclusion que le raisonnement par récurrence est irréductible au principe de contradiction. Cette règle ne peut non plus nous venir de l’expérience ; ce que l’expérience pourrait nous apprendre, c’est que la règle est vraie pour les dix, pour les cent premiers nombres par exemple, elle ne peut atteindre la suite indéfinie des nombres, mais seulement une portion plus ou moins longue mais toujours limitée de cette suite » (Poincaré, La Science et l’hypothèse [1906]). |
|
Norman Podhoretz s’interrogeait, dans un article du New York Post du 25 juillet [2006], à propos de la guerre au Liban : « Est-ce que les démocraties libérales n’ont pas évolué à un point où elles ne peuvent plus mener de guerres efficaces à cause du niveau de leurs préoccupations humanitaires pour les autres… ? » Et il poursuivait : « Et si notre erreur tactique en Irak était que nous n’avions pas tué assez de sunnites au début de notre intervention pour les intimider et leur faire tellement peur qu’ils accepteraient n’importe quoi ? Est-ce que ce n’est pas la survie des hommes sunnites entre 15 et 35 ans qui est la raison de l’insurrection et la cause fondamentale de la violence confessionnelle actuelle ? » (Nouvelles d’Orient) |
|
(…) J’ai proposé depuis (dans La redécouverte de l’esprit) un nouvel argument. La distinction la plus profonde qu’on puisse effectuer n’est pas entre l’esprit et la matière, mais entre deux aspects du monde : ceux qui existent indépendamment d’un observateur, et que j’appelle intrinsèques, et ceux qui sont relatifs à l’interprétation d’un observateur ♦. (…)
|
Je trouve dans Wikipédia cette citation de Hayek sur les mots-belettes (les mots Élie Wiesel). Ainsi, le mot « social » serait un mot-belette (je suis bien d’accord) mais non pas les mots « économie » et « économique » qui sont employés uniquement pour faire savant. Elle est bien bonne. Notamment, la réalité économique n’est aucune réalité. Quand Hayek dit « économie de marché » le mot « économie » est là pour dissimuler qu’il dit en fait « marché libre ». Effectivement, comment le marché libre pourrait-il être social puisqu’il est l’anti-société, l’anti-civilisation ?
|
Le 6 février 1979 à l’université de Fribourg, Hayek développa avec la notion américaine du « weasel word » (qui signifie mot-belette ou encore mot ambigu). De même qu’une belette aurait la capacité de vider un œuf en le suçant sans en abîmer la coquille, de même il existerait des mots qui pareillement à cette belette viderait de sens tous les termes auxquels ils sont associés. Selon Hayek, le « mot-belette » par excellence serait le mot « social » : « Personne ne sait vraiment ce qu’il signifie. En revanche, ce que l’on sait, c’est qu’une économie sociale de marché n’est pas une économie de marché, qu’un État social de droit n’est pas un État de droit, qu’une conscience sociale n’est pas une conscience, que la justice sociale n’est pas la justice — et je crains aussi qu’une démocratie sociale ne soit pas une démocratie. » |
|
On peut qualifier de sémiotiques toutes
les théories qui, de Locke jusqu’à la sémiologie française des années 1960, tirent
leurs procédures analytiques d’une définition générale du signe, d’une
réponse à la question de la nature du signe en général. Or il faut se
demander si le fait de chercher à donner une définition du signe en général,
une définition de la nature du signe comme tel, ne revenait pas à perpétuer
le préjugé atomiste qui conduit à déclarer possible l’existence d’un signe
unique. (…) Dans Le Discours
et le Symbole, Ortigues se référait à Saussure, mais il se séparait du
point de vue sémiotique (si l’on entend par là l’idée d’une théorie des
signes qui serait fondée sur le seul principe d’une définition générale du
signe ou de l’unité de sens par les différences diacritiques). On connaît le
slogan : dans la langue, il n’y a
que des différences. Pourtant, l’analyse linguistique ne saurait se
réduire à une étude de la langue, puisqu’il lui faut se donner deux sortes
d’unités signifiantes, les phrases
du discours et les mots de la
langue. « Un discours ne se divise pas en mots. Il se divise en
phrases » (p. 76). Il y a donc toujours deux pôles à considérer :
le pôle du discours (qui a pour unité minimale la phrase) et le pôle de la
langue (qui a pour unité maximale le mot ou, si l’on veut, le
« syntagme »). Du point de vue structural, ou, si l’on préfère, du
point de vue des règles de formation d’un tout complexe, on doit donc éviter
de parler de la structure du signe, car ce serait confondre les conditions de
la formation d’un mot et celles de la formation d’un discours. « Toutes
les règles de la langue ne servent jamais qu’à faire des phrases […]. La
phrase est donc l’ensemble minimum que la parole individuelle puisse
librement construire comme un discours et l’ensemble maximum pour lequel la
langue puisse légiférer » (p. 77). Ainsi, la langue ne légifère pas en matière de phrase,
elle ne détermine pas quelle phrase utiliser dans quelle circonstance (ce
serait confondre une langue et un code des bonnes manières) : elle ne
fixe que les conditions syntaxiques de la construction d’une phrase correcte.
En revanche, la langue comme lexique fournit des unités déjà identifiées (dans le « trésor » que
constitue le vocabulaire) que le locuteur doit choisir (librement) en
fonction de ce qu’il veut dire (ou de ce qu’il veut accomplir par le fait de
tenir son discours). Ces distinctions permettaient à Ortigues d’éviter
l’écueil sur lequel allait s’abîmer l’imposant vaisseau du
« structuralisme généralisé », c’est-à-dire du programme
sémiotique : prendre le système phonologique pour modèle des systèmes
idéologiques, s’imaginer qu’on pourra analyser un mythe ou de façon plus
générale les grands récits, les grandes figurations, comme si les mêmes lois
présidaient à la formation des « unités signifiantes » à tous les
niveaux (phonologique, morphologique, syntaxique, rhétorique et poétique).
Comme il l’écrira plus tard : à la différence des sciences naturelles,
les études humanistes ne peuvent pas proposer des « théories de
composition », autrement dit identifier des unités ultimes (dans un
ordre donné) au terme d’une décomposition d’un discours ou d’un
« ouvrage de l’esprit ». La psychologie du XIXe siècle croyait
en avoir trouvé une (avec les lois de l’« association des idées »,
en réalité des images mentales) ♦.
Mais, justement, cette psychologie associationniste ne peut pas rendre compte
des faits de signification langagière : le sens d’un discours ne peut
pas consister dans des « images » ou des « idées » qui
seraient suscitées par les mots dans l’esprit de l’auditeur. Expliquer le
sens d’un mot, ce n’est pas identifier une image, c’est plutôt donner des
exemples ou des règles d’usage (de ce mot dans des phrases qu’on pourrait
prononcer dans certaines situations).
Le commencement de la sagesse, en cette matière, est donc
de renoncer à parler de la fonction du signe en général et donc aussi de la nature du signe au singulier. En réalité, écrira même Ortigues,
« les notions de signifiant et de signifié ne rendent pas compte de la
distinction entre la langue et le discours » (La forme et le sens en
psychanalyse, 1999). Ce serait une erreur de croire qu’en parlant de la
structure (morphologique) du mot et de la structure (syntaxique) de la
phrase, on applique dans l’un et l’autre cas une même notion générale de
structure signifiante. Or cette erreur a marqué le structuralisme qu’on peut
qualifier de vulgaire, ou plutôt de superficiel,
pour indiquer par là qu’il avait cru pouvoir pratiquer sa définition des
unités signifiantes par des oppositions distinctives en ne se donnant qu’un
seul niveau d’analyse (la célèbre feuille de papier, dont le recto et le
verso figurent les deux faces signifiante et signifiée du langage). Je crois
qu’on peut parler ici d’une critique
interne du structuralisme dans sa version purement « morphologique »,
à savoir justement celle qui s’est imposée dans l’opinion et qui a nourri plusieurs
programmes ambitieux d’analyse des formes culturelles, littéraires, ou encore
des théories psychanalytiques de l’inconscient. Le structuralisme (celui qu’on doit dire superficiel) a confondu
l’organisation d’un assemblage d’unités signifiantes qu’on appellera un
« syntagme » et l’organisation des « parties du
discours » qui seule peut être qualifiée de syntaxique. Mais l’opposition distinctive (entre deux
unités de même niveau) ne suffit pas pour l’analyse linguistique, puisqu’elle
ne nous donne pas la fonction que ces unités peuvent remplir. De façon générale, Ortigues a proposé dans Le Discours et le Symbole une
réflexion sur les « conditions formelles du sens » dont voici la
grande leçon : « qui dit “forme” dit “sélectivité”, qui dit
“fonction” dit “hiérarchie”. Nous sommes toujours obligés de tenir compte de
ces deux types de rapports » (p. 96). On peut aussi le dire en
soulignant que la classification structurale se fait à partir de principes,
qu’elle n’en reste pas à de simples caractères extérieurs : « toute
classification des formes doit trouver sa raison d’être dans une hiérarchie
des fonctions » (p. 98). Cette leçon me semble fournir le sens
ultime de cette réhabilitation, à laquelle travaillait tout le livre, de
l’explication par la causalité formelle dans le domaine des sciences
historiques, c’est-à-dire des « sciences de l’esprit ». Ce texte est
extrait d’une communication présentée au colloque organisé en hommage à
Edmond Ortigues, et qui s’est tenu à l’université Rennes I, les 28 et
29 mars 2003. Vincent Descombes, « Edmond Ortigues et le tournant linguistique », L’Homme,
175-176 - Vérités de la fiction, 2005 |
Holisme et individualisme :
la clarification d’une querelle →
A propos de
V. Descombes, Le complément de sujet
La G4G et la fin de la globalisation →
|
|
“Brave New War” will put
an end to the Brave New World “As the title implies, this book
dares to question the inevitability of the globalist future decreed by the internationalist elites,
a one-world superstate where life is reduced to an administered satisfying of ‘wants’.” |
Polanyi a donc raison : 1) la société se défend, 2) sa défense est internationale. J’ajoute que seules les sociétés archaïques peuvent encore pour l’instant assurer cette défense parce que seules les sociétés archaïques sont encore des sociétés et non des espaces de prostitution et d’élevage de bétail. Ces sociétés archaïques (“pre-modern non-state primary loyalties”, Lind) ne sont pas, comme l’est l’Occident, pleines d’enculés.
La thèse de Robb, soutenue par Lind, est que la G4G est le principal moyen mis en œuvre pour non seulement contrer la globalisation mise en place ces dernières décennies mais également pour la détruire [ et non pas envahir ou conquérir l’Occident. Comme le signale avec insistance Ben Gourion dans sa lettre au général, les territoires des Arabes sont immenses, immenses, immenses, tandis que le million et demi de Palestiniens qui vivaient en Palestine était petit, petit, petit. Pourquoi en voudraient-ils d’autres. De toute façon, tous les Arabes du monde et même tous les musulmans du monde ne tiendraient pas une semaine dans une bataille rangée. C’est bien pourquoi ils combattent d’une autre façon. Or cette façon ne convient que pour défendre son pays et non pour envahir ou conquérir celui des autres. Personne n’a jamais vu une guérilla de conquête ]. La destruction de la globalisation est en bonne voie, de la façon la plus spectaculaire dans la période ouverte le 11 septembre par les actions terroristes et, surtout à notre sens, par les réactions des “pouvoirs”, voire des “États” qui se jugent soi-disant engagés dans la défense de la globalisation. (Les guillemets sont nécessaires tant l’ambiguïté est grande dans ces divers domaines et actions. La question de la définition de ces soi-disant “pouvoirs” et “États” est même au centre de la réflexion telle qu’elle évolue, notamment avec le livre de Robb et le commentaire de Lind.)
Ainsi donc les gens bons avaient parfaitement et immédiatement compris de quoi il s’agissait le 11 septembre : l’attaque de leur foireux « mode de vie ». C’est bien la société qui se défend contre sa négation par le marché libre. Même si Polanyi ne lisait pas le français, même si Polanyi n’avait pas lu Mauss, je suppose que Polanyi ne confondait pas « la société » et « les sociétés », de même que Frege ne confond pas les esprits et l’esprit. Par le terme extrêmement général de « la société » Polanyi veut désigner ce qui dans les sociétés est social, c’est à dire ce qui dans les sociétés est humain ; tandis que le marché libre représente ce qui est anti-humain, une fantastique attaque contre l’humanité. Les gens bons ont très bien compris de quoi il retournait. Voilà pourquoi j’ai débouché le champagne et pourquoi Nabe a vu une lueur d’espoir.
Pendant que j’y pense : le « raid » (razzia, rezzou) est une vieille tradition des Bédouins, qu’ils soient Arabes ou Touaregs. Donc il n’est pas étonnant, finalement, que la transposition du raid à l’échelle mondiale soit le fait d’Arabes (cette idée me vient en lisant l’article de Lind). D’ailleurs, si vous lisez le Coran, vous verrez facilement que c’est un livre de pasteurs et non d’agriculteurs. Le bétail et le butin y tiennent une place importante. Et combien de raids le Prophète mena-t-il contre les idolâtres ? quatre-ving douze il me semble, dont quatre-vingt dix victorieux.
Philosophie, science politique et
religion
dans la théorie de la démocratie de Tocqueville →
(Par Serge
Champeau)
|
On voit qu’il ne faut pas interpréter trop rapidement, dans un sens traditionaliste, les textes de Tocqueville sur l’irréligion et sur la nécessité de la religion dans une démocratie. Il me semble, c’est l’hypothèse interprétative dont je parlais tout à l’heure, qu’on pourrait traduire en termes plus contemporains la théorie de Tocqueville. L’irréligion n’est autre que la dissolution de toute opinion commune (qui prenait la forme de la religion à l’époque de Tocqueville) et la religion est l’ensemble de ces croyances communes, qui fondent les mœurs, sans lesquelles il n’y a pas de démocratie. Tocqueville le montre de manière particulièrement claire dans De la démocratie en Amérique : « on ne peut établir le règne de la liberté sans celui des mœurs, ni fonder les mœurs sans les croyances » (II, 13). L’autonomie politique repose donc, en Amérique, sur une hétéronomie : au-delà de la sphère politique, où tout est pensé comme transformable, il y a la sphère des vérités qu’on admet sans discuter (II, 47), la sphère de la croyance qui garantit les mœurs, conditions de la démocratie : « en Amérique, c’est la religion qui mène aux Lumières ; c’est l’observation des lois divines qui conduit l’homme à la liberté » (II, 45). (I. Philosophie, science politique et religion dans la théorie de la démocratie de Tocqueville, p. 18) |
Note : Richard Posner est une ordure. J’aurai fait un bon flic. Je mémorise à mon insu les noms et je m’en souviens involontairement, fut-ce trois années après. Quand je lus « Richard Posner » sous la plume de M. Champeau : « J’essaie de montrer comment l’idéalisme des théories de la démocratie délibérative a produit en retour une réaction réaliste, pessimiste, voire cynique (avec les travaux du grand juriste Richard Posner), qui insiste sur la réalité de la démocratie de masse », ça a fait tilt. Une fois de plus, je ne me suis pas trompé. Jugez-en par vous même →.
|
On imagine qu’il n’y a qu’un pas, du constat pessimiste de Zakaria, à l’affirmation selon laquelle la politique ne consiste pas en un échange réglé de raisons dans le cadre d’une délibération [ Ça c’est une pure connerie à la Habermas ] mais en un processus conflictuel qui débouche sur un compromis d’intérêts toujours instable. J’ai parlé, plus haut, des versions démocrates-radicales de cette idée. Je me contenterai de dire quelques mots de sa version conservatrice. Le meilleur représentant de ce courant est sans doute le grand juriste Richard Posner. Il est clair que pour lui la liberté [ La liberté de qui ? ] est plus essentielle que la démocratie : « la démocratie est illibérale et le libéralisme non démocratique (pour ma part je préfère définir le libéralisme comme un régime démocratique où les lois protègent les libertés) » (Law, Pragmatism and Democracy). Les citoyens de nos sociétés [ bétail et prostitués dans la grande majorité ] sont, selon Posner, plus attachés à disposer de garanties contre l’empiétement de l’État sur leur propre vie qu’à participer à des débats démocratiques [ Qui, quand, comment et pourquoi, à fait qu’advienne cet état des choses. Ceux qui se réclament du mal qu’ils ont fait pour en faire d’autre, comme d’habitude depuis trois siècles ]. L’essence de la démocratie représentative n’est d’ailleurs pas la délibération : sa fonction est « de gérer les conflits entre les individus qui, raisonnant la plupart du temps à partir de prémisses incompatibles, ne peuvent surmonter leurs différences par la discussion » (ibid, 112). Il arrive fréquemment que la délibération divise, déstabilise, entraîne des dysfonctionnements et des pertes de temps (112). Bref, la démocratie fonctionne bien sans délibération, elle suppose seulement le common sense des électeurs (« un garde-fou contre les projets délirants » [ par exemple enfoncer des aiguilles stérilisées sous les ongles des prévenus ]), la political ability des gouvernants et l’ordinary competence des fonctionnaires [ Et ainsi, les vaches seront bien gardées ce qui est le but poursuivi. ]. (II. Démocratie délibérative et démocratie représentative, p. 17) |
Polanyiyya. La véritable invention du besoin
Le besoin est le fondement de ce monde
Le besoin est la mine des riches
Le besoin est la condition des si vils innocents
|
Avant que je ne lise Polanyi, je pensais que La Grande transformation était celle survenue après 1840 et l’abolition des lois sur les pauvres et sur les grains en Angleterre. Or il n’en est rien. Pour Polanyi, la grande transformation a lieu depuis 1929 après l’échec général du marché libre et de l’étalon or. Après lecture, je continue à penser que la véritable grande transformation est celle de 1840 : la chute de l’humanité dans le besoin à partir du foyer d’infection anglais. L’humanité est toujours plongée dans le besoin — c’est-à-dire dans l’inhumanité — plus que jamais ; elle le sera peut-être toujours. C’est pourquoi sa disparition ne serait pas une grande perte. |
|
J’ai gardé
trois opinions sur l’Orient depuis l’époque où j’écrivis ce Mémoire : 1° Si la Turquie d’Europe doit être dépecée, nous devons avoir un lot dans ce morcellement par un agrandissement de territoire sur nos frontières et par la possession de quelque point militaire dans l’Archipel. Comparer le partage de la Turquie au partage de la Pologne est une absurdité. 2° Considérer la Turquie telle qu’elle était au règne de François Ier, comme une puissance utile à notre politique, c’est retrancher trois siècles de l’histoire. 3° Prétendre civiliser la Turquie en lui donnant des bateaux à vapeur et des chemins de fer, en disciplinant ses armées, en lui apprenant à manœuvrer ses flottes, ce n’est pas étendre la civilisation en Orient, c’est introduire la barbarie en Occident : des Ibrahim [fils aîné de Mehemet Ali] futurs pourront amener l’avenir au temps de Charles Martel, ou au temps du siège de Vienne, quand l’Europe fut sauvée par cette héroïque Pologne sur laquelle pèse l’ingratitude des rois. Je dois remarquer que j’ai été le seul, avec Benjamin Constant, à signaler l’imprévoyance des gouvernements chrétiens : un peuple dont l’ordre social est fondé sur l’esclavage et la polygamie est un peuple qu’il faut renvoyer aux steppes des Mongols. En dernier résultat, la Turquie d’Europe, devenue vassale de la Russie en vertu du traité d’Unkiar Skelessi n’existe plus : si la question doit se décider immédiatement, ce dont je doute, il serait peut-être mieux qu’un empire indépendant eût son siège à Constantinople et fît un tout de la Grèce. Cela est-il possible ? je l’ignore. Quant à Méhémet-Ali, fermier et douanier impitoyable, l’Égypte, dans l’intérêt de la France, est mieux gardée par lui qu’elle ne le serait par les Anglais. Mais je m’évertue à démontrer l’honneur de la Restauration ; eh ! qui s’inquiète de ce qu’elle a fait, surtout qui s’en inquiétera dans quelques années ? Autant vaudrait m’échauffer pour les intérêts de Tyr et d’Ecbatane : ce monde passé n’est plus et ne sera plus. Après Alexandre, commença le pouvoir romain ; après César, le christianisme changea le monde ; après Charlemagne, la nuit féodale engendra une nouvelle société ; après Napoléon, néant : on ne voit venir ni empire, ni religion, ni barbares. La civilisation est montée à son plus haut point, mais civilisation matérielle, inféconde, qui ne peut rien produire, car on ne saurait donner la vie que par la morale ; on n’arrive à la création des peuples que par les routes du ciel : les chemins de fer nous conduiront seulement avec plus de rapidité à l’abîme. (Mémoires, L. XXIX, C. 12) |
Conclusion pour le XXIe siècle (de defensa)

Le
général de l’USAF Hayden, directeur de la CIA
|
Conclusion pour le XXIème siècle (15-07-2006) Rumsfeld avait-il raison le 10 septembre 2001 ? Nous n’avons jamais cessé de le croire. Il est vrai que le processus bureaucratique constitue le cancer structurel des temps modernistes. (Il n’est pas sûr que Rumsfeld le dénonça dans cet esprit et avec cette conscience mais la dénonciation est là.) Il représente parfaitement ce que la démarche moderniste offre en matière de perversion en organisant l’irresponsabilité puisqu’il marie la puissance et l’illégitimité. Le processus bureaucratique impose une situation qui est une attaque directe contre la légitimité du pouvoir, par conséquent une attaque contre la souveraineté et contre l’identité. Derrière son apparence structurée, la bureaucratie est profondément déstructurante parce qu’elle propose une évolution structurelle qui est une entropie du pouvoir par organisation systémique de l’irresponsabilité. (D’où la facilité avec laquelle des bureaucraties transnationales et supranationales se mettent en place : elles sont naturellement bien placées pour une situation qui est par essence un déni de souveraineté et d’identité.) Si l’on considère qu’il est un mal inévitable (plus qu’un mal nécessaire) dû aux caractères de nos sociétés, le processus bureaucratique ne peut être efficacement combattu et contenu que par la légitimité du pouvoir politique, — lorsque ce pouvoir politique représente la souveraineté et l’identité par un caractère régalien absolument nécessaire, et à cette condition sine qua non. Le système américaniste n’a aucune de ces choses : il n’est pas régalien, il ne représente aucune identité et n’exerce aucune souveraineté fondamentale, il n’a pas de légitimité régalienne. Quel que soit l’homme, quels que soient ses fautes et ses vices, quelle que soit sa responsabilité dans les malheurs qui nous accablent depuis le 11 septembre 2001, il faut reconnaître que Rumsfeld avait identifié et dénoncé le grand, le véritable danger du XXIème siècle, — lequel, dans les conditions actuelles où ce danger est totalement laissé à lui-même, pourrait être un “court XXIème siècle” tant la prolifération bureaucratique précipite la crise générale. Il faut également admettre qu’il (Rumsfeld) avait partie perdue d’avance.
|
Ce livre a l’air enthousiasmant. Que ne l’ai-je lu plus tôt ? Demain je mettrais en ligne l’enthousiasmante préface de Dumont. Dans l’immédiat, je vous livre ceci qui est plutôt malvenu. Je lis dans les annexes :
Engels et Marx n’ont pas étudié la loi sur les pauvres. On peut imaginer que rien ne leur aurait mieux convenu que de montrer le caractère pseudo-humanitaire d’un système qui avait la réputation de flatter bassement les caprices des pauvres, alors qu’il faisait en réalité tomber leurs salaires au-dessous du niveau de subsistance (puissamment aidé en cela par une loi antisyndicale) et donnait l’argent public aux riches pour les aider à tirer plus de revenu des pauvres. Mais, à leur époque, l’ennemi, c’était la nouvelle loi sur les pauvres, et Cobbett et les chartistes avaient tendance à idéaliser l’ancienne. En outre, Engels et Marx étaient convaincus, à juste titre, que si le capitalisme devait arriver, la réforme de la loi sur les pauvres était inévitable. C’est ainsi que leur échappèrent, non seulement certaines matières à controverse de premier ordre, mais encore l’argument par lequel Speenhamland renforçait leur système théorique, à savoir que le capitalisme est incapable de fonctionner sans un marché libre du travail.
Alors, et ça, qu’est-ce que c’est :
A la fin du XVIIIe siècle et pendant les vingt premières années du XIXe les fermiers et les landlords anglais rivalisèrent d’efforts pour faire descendre le salaire à son minimum absolu. A cet effet on payait moins que le minimum sous forme de salaire et on compensait le déficit par l’assistance paroissiale. Dans ce bon temps, ces ruraux anglais avaient encore le privilège d’octroyer un tarif légal au travail agricole, et voici un exemple de l’humour bouffon dont ils s’y prenaient : « Quand les squires fixèrent, en 1795, le taux des salaires pour le Speenhamland, ils avaient fort bien dîné et pensaient évidemment que les travailleurs n’avaient pas besoin de faire de même... Ils décidèrent donc que le salaire hebdomadaire serait de trois shillings par homme, tant que la miche de pain de huit livres onze onces coûterait un shilling, et qu’il s’élèverait régulièrement jusqu’à ce que le pain coûtât un shilling cinq pence. Ce prix une fois dépassé, le salaire devait diminuer progressivement jusqu’à ce que le pain coûtât deux shillings, et alors la nourriture de chaque homme serait d’un cinquième moindre qu’auparavant. »
En 1814, un comité d’enquête de la Chambre des lords posa la question suivante à un certain A. Bennet, grand fermier, magistrat, administrateur d’un workhouse (maison de pauvres) et régulateur officiel des salaires agricoles : « Est ce qu’on observe une proportion quelconque entre la valeur du travail journalier et l’assistance paroissiale ? Mais oui, répondit l’illustre Bennet; la recette hebdomadaire de chaque famille est complétée au delà de son salaire nominal jusqu’à concurrence d’une miche de pain de huit livres onze onces et de trois pence par tête... Nous supposons qu’une telle miche suffit pour l’entretien hebdomadaire de chaque membre de la famille, et les trois pence sont pour les vêtements. S’il plaît à la paroisse de les fournir en nature, elle déduit les trois pence. Cette pratique règne non seulement dans tout l’ouest du Wiltshire, mais encore, je pense, dans tout le pays. »
C’est ainsi, s’écrie un écrivain bourgeois de cette époque, « que pendant nombre d’années les fermiers ont dégradé une classe respectable de leurs compatriotes, en les forçant à chercher un refuge dans le workhouse... Le fermier a augmenté ses propres bénéfices en empêchant ses ouvriers d’accumuler le fonds de consommation le plus indispensable ». L’exemple du travail dit à domicile nous a déjà montré quel rôle ce vol, commis sur la consommation nécessaire du travailleur, joue aujourd’hui dans la formation de la plus-value et, par conséquent, dans l’accumulation du capital. On trouvera de plus amples détails à ce sujet dans le chapitre suivant.
Le Capital - Livre premier, VIIe section, Chapitre XXIV. Effectivement, ce n’est pas ce qu’on peut appeler « une étude »
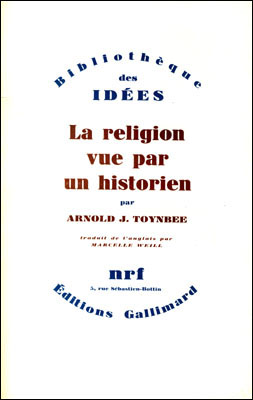
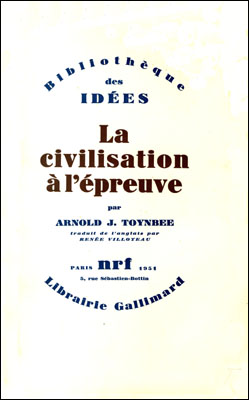
|
Ce que l’Occident est en train de faire à l’Islam, il le fait en même temps aux autres civilisations survivantes — chrétiens orthodoxes, Indiens, monde extrême-oriental — et aux sociétés primitives survivantes qui sont actuellement aux abois, même dans leurs ultimes réduits d’Afrique tropicale. Ainsi, la rencontre contemporaine entre l’Islam et l’Occident n’est pas seulement plus active et plus intime qu’en aucune autre période de leur contact dans le passé : elle est également remarquable du fait qu’elle ne constitue qu’un incident dans une entreprise de l’homme occidental pour « occidentaliser » le monde — entreprise qui comptera peut-être comme la plus considérable, et presque certainement comme le fait le plus intéressant de l’histoire, même pour une génération qui aura vécu les deux guerres mondiales. Une fois de plus, l’Islam, le dos au mur, fait donc face à l’Occident ; mais cette fois, sa situation est beaucoup plus grave qu’elle ne l’était au moment le plus critique des Croisades, car l’Occident moderne ne lui est pas supérieur que par les armes, il le domine aussi par la technique de la vie économique dont dépend en dernière analyse la science militaire, et pardessus tout par sa culture spirituelle — la force intérieure qui, seule crée et soutient les manifestations extérieures de ce qu’on appelle civilisation. Chaque fois qu’une société civilisée se trouve dans cette dangereuse situation vis-à-vis d’une autre, deux voies s’offrent à elle pour répondre à cette menace : et nous pouvons voir de clairs exemples de ces deux genres de réponse dans la réaction de l’Islam à la pression actuelle de l’Occident. Il est aussi légitime que commode d’appliquer à la présente situation certaines expressions qui furent forgées quand se présenta une situation similaire, lors de la rencontre entre les civilisations antiques de la Grèce et de la Syrie. Sous le choc de l’hellénisme au cours des siècles qui précédèrent et suivirent immédiatement le commencement (le l’ère chrétienne, les Juifs (et nous pourrions ajouter les Iraniens et les Égyptiens) se scindèrent en deux fractions. Les uns devinrent « zélotes » et les autres « hérodiens ». Le « zélote » est l’homme qui de l’inconnu se réfugie dans le familier ; lorsqu’il est aux prises avec un étranger qui pratique une tactique supérieure et emploie des armes formidables, d’invention nouvelle, il riposte en pratiquant son art traditionnel de la guerre avec une exactitude anormalement scrupuleuse. On peut, en fait, définir le « zélotisme » comme un archaïsme suscité par une pression extérieure ; et ses représentants les plus remarquables dans l’Islam contemporain sont des « puritains » comme les Senoussis de l’Afrique du Nord et les Wahhabites de l’Arabie centrale. La première chose à noter au sujet des « zélotes » de l’Islam est que leurs bastions se trouvent en des régions stériles, peuplées de façon sporadique, éloignées des principales lignes de communication internationales du monde moderne, et, jusqu’à l’aube récente de l’âge du pétrole, négligées par l’esprit d’entreprise occidental. L’exception, confirmant la règle jusqu’à présent, est le mouvement mahdiste qui domina le Soudan oriental de 1883 à 1898. Le mahdi soudanais, Mohamed Ahmad, s’établit à cheval sur la voie fluviale du Haut-Nil après l’entreprise occidentale d’« ouverture de l’Afrique ». Dans cette fâcheuse situation géographique, le khalife des mahdis soudanais se heurta à une puissance occidentale et — opposant des armes archaïques à des modernes — fut complètement submergé. Nous pouvons comparer la carrière du Mahdi à l’éphémère triomphe des Macchabées pendant le court relâchement de pression de l’hellénisme, dont profitèrent les juifs après que les Romains eurent abattu le pouvoir des Séleucides, et avant qu’ils n’aient pris leur place ; et nous pouvons en inférer que, de même que les Romains avaient écrasé les juifs « Zélotes » aux Ie et IIe siècles de l’ère chrétienne, de même, une grande puissance quelconque du monde occidental d’aujourd’hui — disons les États-Unis — pourrait maintenant, quand elle le voudrait, écraser les Wahhabites si le « zélotisme » wahhabite devenait gênant au point de valoir la peine qu’on le supprimât. [funny !] Nous pouvons supposer par exemple, que le gouvernement arabe Saudi, sous la pression de ses fanatiques partisans, exige des conditions exorbitantes pour les concessions de pétrole ou se dispose à interdire tout à fait l’exploitation de ses ressources pétrolières. [Ah ! la vie est toujours verte et, aujourd’hui, la mort aussi] La découverte récente de ces ressources cachées dans son sol aride est décidément une menace à l’indépendance de l’Arabie ; car l’Occident a maintenant appris à vaincre le désert en mettant dans le jeu ses inventions techniques — chemins de fer et autos blindées, tracteurs qui peuvent ramper comme des mille-pattes sur les dunes de sable, et avions qui peuvent les survoler comme des vautours. Effectivement, dans le Rif marocain, dans l’Atlas, et sur la frontière Nord-Ouest de l’Inde, l’Occident a montré entre les deux guerres qu’il était capable de terrasser des « zélotes » musulmans bien plus formidables à combattre que les habitants du désert. [funny !] Dans ces bastions montagneux, les Français et les Britanniques ont rencontré et vaincu des montagnards qui s’étaient procuré des armes légères occidentales modernes et qui avaient appris à merveille à en tirer le plus grand avantage sur leur propre terrain. Mais il va de soi que le « zélote » armé d’un fusil a tir rapide sans fumée, cesse d’être un « zélote » pur et sans tache, car dès l’instant qu’il a adopté l’arme de l’Occidental, il a mis les pieds sur un terrain qui n’est plus un sol consacré. Certainement, si jamais il y pense — chose peu probable, le tempérament « zélote » étant essentiellement irrationnel et instinctif — il se dit dans son cœur qu’il ira jusque-là, mais pas plus loin ; et qu’ayant adopté juste assez de technique militaire occidentale pour tenir à portée de fusil n’importe quelle puissance agressive occidentale, il consacre sa liberté ainsi préservée à « respecter la loi » sous tous les autres égards et continuera par là-même à mériter les bénédictions de Dieu pour lui et pour sa postérité. [Plus loin il est question d’une vieille connaissance, cette crapule de Dr John Bowring : « Le free trade, c’est Jésus-Christ, Jésus-Christ, c’est le free-trade », auteur d’un rapport sur l’État de l’Égypte en 1839 ] (…) L’« hérodien » est l’homme qui agit en appliquant le principe suivant : la meilleure façon de se défendre contre l’inconnu est d’en maîtriser le secret. Et quand il est placé dans le cas difficile, d’affronter un adversaire plus entraîné et mieux armé, il riposte en abandonnant son art militaire traditionnel et en apprenant à combattre avec la tactique et les armes de son ennemi. Si le « zélotisme » est une forme d’archaïsme suscitée par une pression étrangère, l’« hérodianisme » est une forme de cosmopolitisme suscitée, précisément, par le même agent extérieur ; et tandis que les réduits du « zélotisme » musulman moderne se trouvent dans les steppes et oasis inhospitalières du Najd et du Sahara, ce n’est pas par accident que l’« hérodianisme » musulman moderne — lequel est né des mêmes forces et a peu près à la même époque, il y a un peu plus d’un siècle et demi — s’est concentré à Constantinople et au Caire depuis le temps de Sélim III et de Méhémet Ali. Géographiquement, Constantinople et le Caire sont à l’extrême opposé, dans l’Islam moderne, de la capitale wahhabites de Riyad dans les steppes du Najd et du bastion senoussi de Koufra. Les oasis qui ont fait la force du « zélotisme » sont des moins accessibles ; les villes qui ont été les berceaux de l’« hérodianisme » musulman sont situées sur les grandes voies internationales naturelles des détroits de la mer Noire et de l’isthme de Suez, ou à leur proximité immédiate ; et pour cette raison, aussi bien que par suite de l’importance stratégique et des ressources économiques des deux pays dont elles ont été capitales respectives. Le Caire et Constantinople ont toujours exercé une attraction considérable sur l’esprit d’entreprise occidental depuis que l’Occident moderne a commencé à resserrer son filet autour de la citadelle de l’Islam. Il va de soi que l’« hérodianisme » est de beaucoup la plus efficace des deux ripostes utilisables par une société acculée à la défensive par le choc d’une force étrangère de puissance supérieure. Le « zélote » essaie de trouver un abri dans le passé, comme l’autruche qui enterre sa tête dans le sable pour se dérober à ses poursuivants ; l’« hérodien » affronte courageusement le présent et explore l’avenir. Le « zélote » agit par instinct, l’« hérodien » par raison. En fait l’« hérodien » doit faire un double effort d’intelligence et de volonté pour surmonter l’impulsion « zélote » qui est la première réaction normale et spontanée de la nature humaine à la menace à la fois dirigée contre le « zélote » et l’« hérodien ». Être devenu « hérodien » est en soi une preuve de caractère (pas nécessairement d’aimable caractère) ; et il est à remarquer que les japonais, qui de tous les peuples défiés par l’Occident moderne ont peut-être été jusqu’à présent les représentants les moins heureux du monde, de l’« hérodianisme », avaient été auparavant les plus brillants « zélotistes » de 1630 à 1860. Grâce à leur force de caractère, les Japonais tirèrent le meilleur parti possible de la réponse « zélote » ; et pour la même raison, quand la dureté des faits finit par les convaincre que persévérer dans cette voie les conduirait à un désastre, délibérément, ils firent virer leur navire pour tirer une bordée dans le sens de l’« hérodianisme ». L’« hérodianisme » cependant, tout en constituant une réponse incomparablement plus efficace que le « zélotisme » à l’inexorable « question occidentale » posée à tout le monde contemporain, n’offre pas une vraie solution. Sous certain rapport, c’est un jeu dangereux ; et pour prendre une autre métaphore, c’est comme de changer de cheval en traversant un fleuve, le cavalier qui n’arrive pas à enfourcher sa nouvelle selle est poussé par le courant â une mort aussi certaine que celle qui attend le « zélote » quand celui-ci charge contre une mitrailleuse avec sa lance et son bouclier. Le passage est périlleux et beaucoup y laissent leur vie. En Égypte et en Turquie par exemple — les deux pays qui ont servi de champ d’expérience aux pionniers musulmans de l’« hérodianisme » — les épigones se sont révélés inférieurs à la tâche extraordinairement difficile que les « anciens hommes d’État » leur avaient léguée. Le résultat fut que dans les deux pays, moins de cent ans après son début, le mouvement « hérodien » buta sur un insuccès, c’est-à-dire dans les premières années du dernier quart du XIXe siècle ; et les retards, les effets de stérilité consécutifs â cet échec, sont encore péniblement ressentis, à bien des égards, dans la vie des deux pays. Deux autres faiblesses de l’« hérodianisme », encore plus graves parce que congénitales, apparaissent dans la Turquie d’aujourd’hui. Après avoir surmonté l’échec hamidien par un héroïque tour de force, ses dirigeants ont conduit l’« hérodianisme » à sa conclusion logique â travers une révolution qui, par son caractère impitoyable et absolu, repousse dans l’ombre même, les deux révolutions japonaises classiques des XVIIe et XIXe siècles. Ici, en Turquie, il s’agit d’une révolution qui, au lieu de se confiner sur un plan unique, comme nos successives révolutions économique, politique, esthétique et religieuse, s’est placée sur tous ces plans â la fois, et a, par conséquent, bouleversé toute la vie du peuple turc, du haut en bas de son activité et de son expérience sociales. Les Turcs ne se sont pas contentés de changer leur constitution. (ce qui était une affaire relativement simple, au moins quant aux formes) ; cette République novice a en outre déposé le Défenseur de la Foi de l’Islam et aboli sa charge, le califat ; elle a ôté le voile du visage des femmes, en répudiant tout ce qu’impliquait ce voile ; elle a obligé les hommes à se confondre avec les incroyants en portant des chapeaux à bord qui empêchent d’accomplir le rite traditionnel de l’Islam, consistant à toucher le sol de la mosquée du front ; elle a proprement balayé la loi de l’Islam en traduisant en turc le code civil suisse mot pour mot et le code pénal italien avec des adaptations, et en leur donnant force de loi par un vote de l’Assemblée Nationale ; elle a échangé les caractères arabes pour les latins, changement qui ne pouvait s’opérer sans jeter par dessus bord la plus grande part du vieux patrimoine littéraire ottoman. Enfin, changement plus radical et plus audacieux encore, ces révolutionnaires « hamidiens » de Turquie ont imposé à leur peuple un idéal social nouveau — les invitant à se détourner de la vie du laboureur, du guerrier ou du seigneur, pour entrer dans le commerce et l’industrie et prouver ainsi qu’ils étaient capables de rivaliser avec les Occidentaux aussi bien qu’avec les Grecs occidentalisés, les Arméniens ou les Juifs, dans des activités qui, traditionnellement, leur paraissaient méprisables et indignes d’un effort de compétition. Cette révolution « hérodienne » de Turquie a été opérée dans cet esprit avec des handicaps si sérieux et contre de telles difficultés que tout observateur généreusement disposé lui pardonnera ses bévues, voire ses crimes, et lui souhaitera de mener à bien sa tâche formidable. Tantus labor non sit cassus — et il serait particulièrement inconvenant pour un observateur occidental de railler ; car, après tout, ces Turcs « hérodiens » avaient commencé par essayer d’orienter leur peuple et leur pays vers quelque chose que, depuis la rencontre de l’Islam et de l’Occident, nous leur avions toujours dénoncée comme contraire à la nature ; c’est alors qu’ils ont essayé, sur le tard, de produire chez eux la réplique d’une nation occidentale et d’un État occidental. Et nous, à peine en avons-nous clairement aperçu le but, que nous ne pouvons nous empêcher de nous demander si tous ces efforts dépensés pour l’atteindre en valent réellement la peine. Certainement nous n’aimions pas le Turc « zélote » outrageusement démodé, qui se gaussait de nous, dans la posture du pharisien remerciant Dieu chaque jour de n’être pas ce que sont les autres hommes. Tant qu’il se faisait gloire d’être un peuple à part, nous rabaissions son orgueil en déclarant ce particularisme odieux à force de l’appeler l’« ineffable Turc », nous avons réussi à percer son armure psychologique et à l’exciter à cette révolution « hérodienne » qu’il a maintenant consommée sous nos yeux. A présent que, sous l’aiguillon de nos critiques, il a changé son fusil d’épaule, à présent qu’il cherche par tous les moyens à ce qu’on ne puisse plus le distinguer des nations qui l’entourent, nous voilà embarrassés et même enclins à l’indignation — comme l’était Samuel quand les Israélites avouaient la vulgarité des motifs leur faisant demander un roi. Nos critiques actuelles des Turcs sont donc fort déplacées, c’est le moins qu’on puisse dire. Et la victime de notre censure pourrait nous rétorquer que, quoi qu’elle fasse, elle ne trouve jamais grâce à nos yeux ; elle pourrait en appeler contre nous à ce passage de nos Écritures : « Nous avons joué de la flûte pour vous, et vous n’avez pas dansé ; nous avons pris le deuil pour vous et vous n’avez pas pleuré. » Du fait que nos critiques soient inélégantes, il ne s’ensuit cependant pas qu’elles soient absolument captieuses, qu’elles passent très loin du but. Car après tout, en quoi le patrimoine de la civilisation sera-t-il accru si ces efforts ne se révèlent pas vains et si l’objectif de ces Turcs « hérodiens » et outranciers est atteint dans la plus grande mesure possible ? C’est ici qu’apparaissent les deux faiblesses inhérentes à l’« hérodianisme ». La première réside en ceci, que l’« hérodianisme », par hypothèse, est mimétique et non créateur, si bien que, même dans sa réussite, il n’est apte qu’à augmenter la quantité de produits mécaniquement fabriqués par imitation d’une société étrangère, au lieu de libérer dans les âmes humaines des énergies créatrices nouvelles. La seconde de ces faiblesses est que ce succès, stérile en fait d’inspiration nouvelle, et qui est ce que l’« hérodianisme » a de mieux à offrir, ne peut apporter le salut — salut d’ailleurs purement terrestre — qu’à une faible minorité de cette communauté qui s’engage sur le chemin de l’« hérodianisme ». La majorité, les autres, ne peuvent même pas espérer devenir des membres passifs de la civilisation imitée. Mussolini fit un jour cette remarque perçante qu’il y a des nations prolétaires aussi bien que des classes et des individus prolétaires ; et c’est bien la catégorie dans laquelle entreront probablement les peuples non-occidentaux, même si par un tour de force de l’« hérodianisme », ils réussissent apparemment à transformer leurs pays en États souverains indépendants sur le modèle occidental et s’associent avec leurs frères occidentaux en tant que membres nominalement libres et égaux d’une société internationale embrassant la totalité du monde. Par conséquent, et pour ce qui est de notre sujet — l’influence que la rencontre entre Islam et Occident peut avoir sur l’avenir de l’humanité — nous pouvons négliger à la fois les « zélotes » et les « hérodiens » musulmans, dans la mesure où leurs réactions sont vouées à l’insuccès : et le succès extrême qu’ils puissent espérer est une réalisation négative, une survivance matérielle. Le rare « zélote » qui puisse échapper à l’extermination devient le fossile d’une civilisation éteinte en tant que force vivante ; l’« hérodien », plutôt moins rare, qui échappe à la destruction, devient un mime de la civilisation vivante à laquelle il s’assimile. Ni l’un ni l’autre ne sont en mesure d’apporter la moindre contribution créatrice à une croissance ultérieure de cette civilisation vivante. Nous pouvons incidemment noter que, dans la rencontre moderne entre Islam et Occident, les réactions « hérodiennes » et « zélotes » se sont effectivement heurtées plusieurs fois et se sont jusqu’à un certain point annulées réciproquement. La première utilisation que Méhérnet Ali fit de son armée « occidentalisée » consista â attaquer les Wahhabites et à réprimer les premières explosions de leur zèle. Deux générations plus tard, ce fut le soulèvement du Mahdi contre le régime égyptien en Soudan oriental qui donna le coup de grâce au premier effort « hérodien » pour faire de l’Égypte une puissance capable de se tenir politiquement sur ses pieds « au milieu des âpres conditions du monde moderne »; ce fut cela qui confirma l’occupation militaire britannique de 1882, avec toutes les conséquences politiques qui en ont découlé depuis. Autre exemple contemporain la décision du dernier roi d’Afghanistan de rompre avec une tradition « zélote » qui avait été le trait dominant de la politique afghane depuis la première guerre anglo-afghane de 1838-42; cette décision a probablement fixé le destin des tribus « zélotes » le long de la frontière nord-ouest de l’Inde. En effet, bien que l’impatience du roi Amanullah n’ait pas tardé à lui coûter son trône et à provoquer une réaction « zélote » parmi ses anciens sujets, on peut prédire à coup sûr que ses successeurs — et d’une façon d’autant plus sûre qu’elle sera plus lente — vont suivre la même voie « hérodienne ». Et le progrès de l’« hérodianisme » en Afghanistan signifie la condamnation de ces tribus. Tant que celles-ci avaient derrière elles un Afghanistan pratiquant contre la pression de l’Occident cette politique de réaction qu’elles avaient elles-mêmes adoptée d’instinct, elles pouvaient continuer à suivre impunément le chemin du « zélotisme ». Maintenant qu’elles sont prises entre deux feux — d’un côté l’Inde comme précédemment [ vive le Pakistan et les Pakistanais ], et, de l’autre, l’Afghanistan qui s’est engagé dans la voie de l’« hérodianisme », ces tribus semblent tôt ou tard appelées à choisir entre le conformisme et l’extermination [ pour l’instant elles tiennent les Américains par les couilles après avoir tenu celles des Anglais, il y a plus d’un siècle ]. Notons au passage que l’« hérodien », s’il vient à se heurter à son compatriote « zélote », est capable de le traiter de façon bien plus impitoyable que ne le ferait l’Occidental. L’Occidental châtie le « zélote » musulman avec le fouet ; l’« hérodien » musulman le châtie avec des scorpions. L’effroyable rigueur avec laquelle le roi Amanullah réprima sa révolte des Pathans en 1924, et le président Mustapha Kémal sa révolte kurde en 1925, offre un contraste frappant avec les méthodes plus humaines par lesquelles, précisément à la même époque, d’autres Kurdes récalcitrants furent domptés dans l’Irak, ainsi que d’autres Pathans à la province frontière nord-ouest de ce qui était l’Inde britannique. A quelle conclusion cette enquête nous conduit-elle ? Allons-nous, pour les besoins de notre cause, et du fait que nous ne tenons compte ni des « hérodiens » ni des « zélotes » musulmans ayant réussi, allons-nous conclure que la présente rencontre Islam-Occident n’aura aucune influence sur l’avenir de l’humanité ? En aucune façon; en refusant de prendre en considération ces heureux « hérodiens » et « zélotes », nous n’avons mis de côté qu’une faible minorité des membres de la société musulmane. Le destin de la majorité, comme je l’ai déjà indiqué, n’est pas d’être exterminé, ni fossilisé, ni assimilé, il est d’être enrôlé dans ce vaste, cosmopolite et omniprésent prolétariat qui est un des plus sordides sous-produits de l’« occidentalisation » du monde. En première analyse, il pourrait sembler qu’en envisageant ainsi l’avenir de la plupart des musulmans dans un monde « occidentalisé », nous avons complété la réponse à notre question et dans le même sens que précédemment. Si nous convainquons de stérilité l’« hérodien » et le « zélote » musulmans, ne devons-nous pas accuser aussi de la même tare le « prolétaire » musulman ? En vérité, quelqu’un refusera-t-il de souscrire de prime abord à ce verdict ? Nous pouvons imaginer que des archi-hérodiens comme feu le président Mustapha Kemal Ataturk et des archi-zélotes comme le grand Senoussi tomberaient d’accord avec des coloniaux d’Occident, des administrateurs éclairés comme Lord Cromer ou le général Lyautey, pour s’écrier « Peut-on attendre du fellah égyptien ou du hammal de Constantinople la moindre contribution créatrice à la civilisation future ? » Exactement de la même façon, aux premières années de l’ère chrétienne, lorsque la pression de la Grèce se faisait sentir sur la Syrie, Hérode Antipas, Gamaliel et ces zélés Théodas et Judas qui, dans la mémoire de Gamaliel, avaient péri par l’épée, se seraient certainement rencontrés avec un poète grec in partibus orientalium comme Méléagre de Gandara ou avec un Romain gouverneur de province comme Gallius, pour demander sur le même ton ironique « Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth ? » Si la question est posée sous cette forme historique, nous ne doutons pas de la réponse, parce que les civilisations grecque et syrienne ont toutes deux accompli leur carrière et que nous connaissons du commencement à la fin l’histoire de leurs relations. Et cette réponse nous est si familière qu’il nous faut un certain effort d’imagination pour réaliser combien ce verdict particulier de l’histoire aurait été surprenant, voire choquant pour des Grecs, Romains, Iduméens ou juifs intelligents du temps où cette question fut originellement posée. Car, encore que de leurs points de vue profondément différents, ils eussent pu se mettre d’accord sur bien d’autres sujets, presque certainement, à cette question particulière, ils auraient répondu avec ensemble par un « non » emphatique et méprisant. A la lumière de l’histoire, nous pouvons taxer leur réponse d’erreur ridicule si nous prenons comme critérium du bien la manifestation de la puissance créatrice. Dans ce vaste brassage consécutif à l’intrusion de la civilisation grecque dans les civilisations de la Syrie, de l’Iran, de l’Egypte, de la Babylonie et de l’Inde, la stérilité proverbiale des hybrides semble avoir atteint la classe dominante de la société grecque aussi bien que les Orientaux qui suivirent jusqu’au bout l’une des deux voies « hérodienne » ou « zélote ». Le seul milieu de cette société cosmopolite gréco-orientale qui ait incontestablement échappé à ce destin fut le monde inférieur du prolétariat oriental dont Nazareth fut un exemple et un symbole; et de ce monde inférieur, en des conditions apparemment adverses, jaillit une des plus puissantes créations jamais accomplies par l’esprit humain : une floraison de grandes religions. Leurs paroles se sont répandues par toute la terre et résonnent encore à nos oreilles. Leurs noms sont des noms de puissance Christianisme, et Mithraisme, et Manichéisme; l’adoration de la Mère et de son époux-fils mourant et renaissant sous les noms alternés de Cybèle-Isis et d’Attis-Osiris; l’adoration des corps célestes ; et l’école Mahayana du Bouddhisme qui — se transformant de philosophie en religion au cours de sa progression sous les influences iranienne et syrienne — fit rayonner en Extrême-Orient une pensée indienne incarnée dans un art nouveau d’inspiration grecque. Si ces précédents ont à nos yeux une signification quelconque — et ce sont les seuls rayons de lumière que nous puissions projeter dans la nuit qui cache notre avenir, — ils font présager que l’Islam, en pénétrant dans ce monde prolétarien, dans cette couche inférieure de notre actuelle civilisation occidentale, pourra finalement entrer en ligne avec l’Inde, l’Extrême-Orient et la Russie pour leur disputer leur influence sur l’avenir par des moyens qui passent peut-être notre entendement. En vérité, le choc de l’Occident ébranle déjà l’Islam en ses profondeurs, et, même en ces jours prématurés, nous pouvons distinguer certains mouvements spirituels qui pourraient bien devenir les embryons de nouvelles grandes religions. Les mouvements Baha’i et Ahmadi, qui d’Acre et de Lahore ont commencé â envoyer leurs missionnaires en Europe et en Amérique, vont se signaler à l’attention des observateurs contemporains occidentaux; mais arrivés â ce point de nos pronostics, nous avons atteint les Colonnes d’Hercule, l’explorateur prudent doit s’arrêter là et se garder de faire voile vers l’océan des temps futurs, océan dans lequel il ne peut relever que quelques points d’ordre très général. Si nous pouvons nous livrer avec profit à des spéculations sur la forme générale des choses à venir, nous ne pouvons distinguer avec précision qu’à très petite distance les ombres des événements particuliers qui se préparent en avant de nous; et les précédents historiques que nous avons interrogés comme des phares, nous apprennent que les religions nées des chocs entre civilisations mettent plusieurs siècles pour arriver à maturité, et que dans une course qui s’attarde tant, c’est souvent le mauvais cheval qui gagne. Six siècles et demi séparent l’année en laquelle Constantin donna son patronage officiel au christianisme de l’année où Alexandre le Grand avait franchi l’Hellespont; et cinq siècles et demi les premiers pèlerinages chinois à la Terre Sainte bouddhiste du Bihar, de Ménandre, le souverain grec de l’Hindoustan, qui avait posé aux sages bouddhistes indiens la question « Qu’est-ce que la vérité ? » Le heurt actuel de l’Occident sur l’Islam, précédé par une pression qui avait commencé à se faire sentir il y a un peu plus de cent cinquante ans, a évidemment peu de chances, dans ces conditions, de produire des effets comparables en un laps de temps ne dépassant pas la portée de notre faculté de prévoir avec précision; et tout essai de prédire des effets de ce genre pourrait donc n’être qu’un stérile exercice d’imagination. Nous pouvons cependant distinguer certains principes de l’Islam qui, s’ils agissaient sur la vie sociale du nouveau prolétariat cosmopolite, pourraient exercer des effets salutaires sur « la grande société » dans un proche avenir. |
La Civilisation à l’épreuve, « L’Islam, l’Occident et l’avenir » NRF, 1951, disponible d’occasion sur Amazon.
Vous pouvez lire la suite dans la longue citation du même ouvrage que fait M. de Defensa sur « l’extinction de la haine de race qui est un des accomplissements moraux les plus considérables de l’Islam »
Pour ma part, je tiens, comme je l’ai déjà exposé, l’Islam pour le conservateur de la foi (ce qui désole beaucoup M. Naipaul). C’est ce seul principe, la foi, c’est à dire la confiance, qui contredit « la vie sociale » de « la grande société » de l’enculisme généralisé, c’est à dire pas de vie sociale du tout, désert, crapuleux désert.
A propos de « vie sociale de la grande société » et d’enculisme : sévère bizutage chez Renault : trois morts. Les prostitués sont traités comme ils le méritent. Bien fait veautants. Et ce n’est qu’un début. C’est partout Abou Graïb.
Pendant ce temps, le Pantalon frénétique et la Culotte souriante se livrent une impitoyable bataille de polochons.
Toynbee Guerre et civilisation « l’Enivrement de la victoire »
Idées-Gallimard, 1973,
disponible sur Amazon pour la modique
somme de 18 francs.
|
L’une des formes les plus
générales qu’affecte le drame des « excès », des
« outrages » et du « désastre » est celle de l’enivrement
de la victoire, que la lutte où fut remporté le funeste succès ait été la
guerre par les armes ou un conflit de forces spirituelles. Ces deux variantes
du même drame trouvent leur illustration dans l’histoire de Rome :
l’enivrement de la victoire militaire, par l’effondrement de la République au
second siècle av. J.-C. et l’enivrement de la victoire spirituelle, par
l’effondrement de la papauté au IIIe siècle de l’ère chrétienne. La
démoralisation, à laquelle succomba la classe dirigeante de la République
romaine au bout du demi-siècle de guerres titanesques (220-168
av. J.-C.) qui débuta par la terrible épreuve de la guerre d’Annibal et
se termina par la conquête du monde, a été décrite d’une façon piquante par un observateur grec contemporain qui en fut
une des victimes.
Tel est l’abîme moral dans lequel avait été jetée la classe dirigeante romaine par la victoire écrasante échue à la République après des années d’angoisse où elle avait chancelé au bord d’un précipice. La première réaction de la génération qui avait vécu cette stupéfiante aventure fut de s’imaginer que l’irrésistible puissance matérielle du vainqueur offrait la clé de tous les problèmes humains, et que la seule fin concevable de l’homme résidait dans la jouissance effrénée des plaisirs les plus grossiers que cette puissance pouvait lui procurer. Les vainqueurs ne comprirent pas que cet état d’esprit même était la preuve de la défaite morale que le vaincu des armes, Annibal, avait réussi à leur infliger. Ils ne s’aperçurent pas que le monde dans lequel ils passaient pour victorieux était en ruines et que leur République romaine, ostensiblement triomphante, était le plus gravement affligé de tous les Etats accablés dont il était formé. Du fait de cette aberration morale, ils s’égarèrent dans la confusion pendant plus de cent ans, siècle terrible au cours duquel ils infligèrent calamité sur calamité à un univers que la victoire avait mis à leur merci — et les plus graves de toutes à eux-mêmes. Même militairement, dans la monnaie de leur choix, leur
faillite devint bientôt manifeste. Les triomphes chèrement acquis sur un
Annibal et un Percée furent suivis d’une série de revers humiliants en
présence d’adversaires bien inférieurs à Rome au point de vue militaire… 1. POLYBE : Histoire oecuménique, livre XXXI, ch. 25. |
Voilà ce qu’il fallait dire à Munich en 1938.

L’hypothèse que nous émettons est bien que notre civilisation usurpe le terme de civilisation, et même, pire encore, qu’elle ne devrait plus être là, à sa place de civilisation triomphante. A part le fondement intellectuel qu’on peut lui trouver, cette hypothèse a-t-elle quelque cohérence historique ? C’est là où nous voulons en venir, et nous développerons pour cela la substance de l’argumentation étayant notre hypothèse. C’est là où nous nous tournons vers Arnold Toynbee. (de Defensa, 27 juillet 2002)
C’est exactement ce que j’entendais par : « Pour qu’il y ait choc des civilisations, encore faut-il qu’il y ait deux civilisations » et, à mon humble avis, c’est également ce que voulaient signifier l’émir Ben Laden and his followers par leurs messages sans paroles : qu’elle usurpe le terme de civilisation et qu’elle ne devrait plus être là. C’est ce que j’ai essayé de dire dans ma Diatribe : on peut être athée sans être impie. Sursum corda.
Toynbee
et le phénomène du racisme, avec son rôle dans le ‘‘choc des civilisations’’ :
la complète responsabilité des «peuples de langue anglaise»
|
Un passage particulièrement intéressant, encore une
fois à la lumière pressante de nos événements présents et du torrent
virtualiste qui les caractérise, concerne le rôle du racisme dans ces événements
de type “choc des civilisations”. L’appréciation de Toynbee, mesurée dans la
forme, respectueuse des nuances, n’en constitue pas moins une surprise pour
la pensée conformiste post-moderne qui triomphe aujourd’hui. ♦ Les principaux accusés de racisme se
trouvent être « les peuples de
langue anglaise ». Le constat est d’autant plus intéressant
qu’il vient d’un historien anglais, et de la renommée de Toynbee. ♦ Si un frein n’est pas mis à
l’affirmation de ces conceptions et de ces comportements racistes des « les peuples de langue anglaise », Toynbee craint le pire. Cette idée
pourrait tout aussi bien s’appliquer complètement aux événements auxquels
nous assistons aujourd’hui (« Au
point où en sont les choses, les champions de l’intolérance raciale sont dans
leur phase ascendante, et si leur attitude à l’égard de la question raciale
devrait prévaloir, cela pourrait finalement provoquer une catastrophe
générale »). ♦ Toynbee continue pourtant à espérer
dans « les forces qui défendent la
tolérance raciale », dans lesquelles il met, — encore
des surprises pour aujourd’hui, — l’Islam et, d’une certaine façon, les
Français si la fortune de leurs entreprises de colonisation leur avait permis
de prendre le dessus sur « les
peuples de langue anglaise ». Nous publions ce long passage,
des pages 222 et 223 de La Civilisation
à l’épreuve. Il prend tout son sens à être lu aujourd’hui, en
juin 2002.
La Civilisation à l’épreuve, NRF Bibliothèque des Idées, Paris 1951 |
De defensa, 19 juin 2002.
C’est bien ce qui me semblait : les bédouins bombardiers avaient de sérieux motifs pour agir comme ils l’ont fait. Bombarder les bobardeurs.
|
Ces brèves citations auraient pu être intégrées à la
série en cours de « fragments... » - mais même si l’un des
principes qui sous-tendent l’élaboration de ceux-ci pourrait être la
tautologie « tout est dans tout et réciproquement », on ne cherche
pas à y aborder tous les sujets. Simplement, ces quelques lignes de François
Fourquet, publiées en 1997 in La revue du MAUSS me semblent
une bonne introduction au vaste sujet de la négation de
l’économie. (AMG) « Mon but est de suggérer que l’économie et le capitalisme
n’existent pas. En tout cas, pas comme une
partie de la réalité sociale existant en soi et pourvue d’une sorte
d’autonomie, de capacité d’autodétermination, obéissant à des lois de
fonctionnement et de développement propres. Il existe certes des
institutions, des groupes, des flux qui font l’objet d’un ensemble disparate
et souvent conflictuel de politiques économiques. La résultante de ces
politiques est un ensemble nouveau, irréductible, imprévisible, même par les
Etats majeurs de la planète : l’économie mondiale. (...) L’enjeu épistémologique, mais aussi pratique, est simple
: seul existe le tout
; et le tout est immédiatement planétaire. Mais il est aussi multiple et
polyvalent. Les activités, institutions ou flux qu’on sélectionne, qu’on
rassemble et qu’on fait entrer de force dans un récipient verbal appelé “économie” n’ont
aucune sorte d’intelligibilité propre en dehors de leur relation au tout,
puisqu’ils n’existent pas de manière séparée. Les institutions économiques, certes, les entreprises par
exemple, sont des quasi-sujets qui disposent d’une relative capacité de
décision. Rien n’est
mécanique du moment que la subjectivité humaine est en cause. Mais de
l’autonomie relative des groupes et institutions, on ne peut nullement
inférer l’existence d’un ordre économique autonome et articulé avec
les autres ordres. “Capitalisme” est le nom donné à l’immense mouvement
d’unification des civilisations accéléré depuis la fin du Moyen Age. La
“mondialisation” qui se déroule sous nos yeux est l’accélération d’une
accélération. » (François Fourquet, Comment peut-on être
anticapitaliste ? MAUSS semestriel n° 9, 1997) |
American parano →
Jean-Philippe
Immarigeon
Aux USA, « le peuple est gouverné, pas gouvernant, et certainement pas constituant ». Il n’y a pas de peuple, il n’y a pas de nation (il n’y a pas eu d’histoire, la constitution fut écrite from scratch), il n’y a que des individus. Jefferson affirmait que la liberté n’est possible qu’en l’absence de souveraineté. Le résultat c’est qu’une fois élu, l’exécutif est comme un missile de croisière : personne ne peut le rappeler. La seule solution qui reste est de l’abattre en plein vol. Air Force One est le parfait symbole de cette situation.
En faisant semblant de fragmenter le pouvoir,
Jefferson et ses amis ont abouti à ce qu’il soit tout entier dans la présidence
et ont confisqué la souveraineté nationale. Je veux bien leur laisser le
bénéfice du doute, le résultat pervers n’en reste pas moins le même. Car
Jean-Jacques avait finalement raison : même dans un système représentatif
(qu’il refusait), la volonté souveraine ne peut s’exprimer que d’une seule et même
voix, par-delà une séparation formelle des pouvoirs. En Europe, ce sont les
urnes et le parlement qui disent la Loi : aux Etats-Unis, ce sont la
Constitution et le président. Nous ne sommes pas dans le même corpus de
valeurs. (Jean-Philippe Immarigeon)
Nous nous proposions au début de nos études, surtout de comprendre des institutions, c’est-à-dire des règles publiques d’action et de pensée. Dans le sacrifice, le caractère public de l’institution, collectif de l’acte et des représentations est bien clair. La magie dont les actes sont aussi peu publics que possible, nous fournit une occasion de pousser plus loin notre analyse sociologique. Il importait avant tout de savoir dans quelle mesure et comment ces faits étaient sociaux. Autrement dit : quelle est l’attitude de l’individu dans le phénomène social ? Quelle est la part de la société dans la conscience de l’individu ? Lorsque des individus se rassemblent, lorsqu’ils conforment leurs gestes à un rituel, leurs idées à un dogme, sont-ils mus par des mobiles purement individuels ou par des mobiles dont la présence dans leur conscience ne s’explique que par la présence de la société ? Puisque la société se compose d’individus organiquement rassemblés, nous avions à chercher ce qu’ils apportent d’eux-mêmes et ce qu’ils reçoivent d’elle et comment ils le reçoivent. Nous croyons avoir dégagé ce processus et montré comment, dans la magie, l’individu ne pense, n’agit que dirigé par la tradition, ou poussé par une suggestion collective, ou tout au moins par une suggestion qu’il se donne lui-même sous la pression de la collectivité.
Notre théorie se trouvant ainsi vérifiée, même pour le cas difficile de la magie, où les actes de l’individu sont aussi laïcs et personnels que possible, nous sommes bien sûrs de nos principes en ce qui concerne le sacrifice, la prière, les mythes. On ne doit donc pas nous opposer a nous-mêmes si, parfois, nous parlons de magiciens en renom qui mettent des pratiques en vogue, ou de fortes personnalités religieuses qui fondent des sectes et des religions. Car, d’abord, c’est toujours la société qui parle par leur bouche et, s’ils ont quelque intérêt historique, c’est parce qu’ils agissent sur ses sociétés. [ ça ne vous rappelle rien ? ]
Version imprimable (60 pages Verdana corps 10)
|
M. du S. : Les petits-bourgeois ne passent pas leurs vacances à Saint-Tropez ! Ils n’en ont pas les moyens ! R. C. : Ils ne passent pas leurs vacances à Saint-Tropez parce qu’ils n’en ont pas les moyens ! Ils vont un peu voir, tout de même. Et c’est là qu’ils passeraient leurs vacances s’ils en avaient les moyens. C’est là qu’ils passent leurs vacances quand ils en ont les moyens, quand ils sont princesses de Galles, présidents de société, "artistes", maffieux, ministres, président de Conseil régional ou membres de la "jet-set", à un titre ou un autre. La "jet-set", c’est vraiment une invention ou une réinvention typique de la petite bourgeoisie au pouvoir : une sorte de faux ailleurs, de négation frénétique et gâteuse de l’ailleurs, de l’altérité sociale et de l’extérieur culturel ; une espèce de super petite bourgeoisie un peu pégreuse, disposant de tous les moyens et pouvant accomplir tous ses rêves, mais n’ayant de passions et de rêves que petits-bourgeois, des goûts de charcutier-traiteur milliardaire, une vision totalement petite-bourgeoise du monde, et comme telle parfaitement rassurante pour la petite bourgeoisie. Nous ne ratons rien, peuvent se dire les petits-bourgeois – ou bien si, nous ratons quelque chose, mais ça ne tient pas à nous, c’est seulement une question d’argent, pas une question d’éducation, de transmission, de culture : l’argent suffirait pour que nous puissions être pleinement nous-mêmes, c’est-à-dire exactement semblables à ce que nous sommes déjà, avec les mêmes goûts, les mêmes curiosités, les mêmes manières, mais riches à millions M. du S. : Nous nous égarons un peu, et vous voilà repris par les plus durs à cuire de vos vieux dadas, que tous vos lecteurs connaissent bien. R. C. : Peut-être un peu trop, vous avez raison. L’idée que j’essayais d’exprimer, c’est qu’une société petite-bourgeoise est une société où les différences de classe tendent à n’être plus qu’économiques ; où les riches ne sont plus que des pauvres avec de l’argent. Pardon si j’ai fait un peu dévier la ligne de l’échange, et l’ai ramenée à des exemples éculés. Mais cet entretien vise à une sorte de synthèse, n’est-ce pas, de panorama, d’état des lieux, de récapitulation - plus qu’au défrichement de terres nouvelles, non ? Où en étions-nous ? |
J’entends dans le poste l’animateur de l’émission Du Grain à moudre opposer que « le scandale, c’est la pauvreté » à l’un des intervenants qui prétendait que « le scandale, c’est la richesse ». Deux demi-vérités, c’est à dire deux erreurs. Le scandale, tel que le relève Renaud Camus, c’est la pauvreté de la richesse. Les riches ne sont que des pauvres avec de l’argent. Vers 1860 le camarade Karl (Marx) disait déjà que l’argent n’apporte aucune qualité à l’individu.
Mais la proposition de M. Camus est aussi une demi-vérité car la différence entre les pauvres et les riches est que les premiers ne travaillent pas tandis que les seconds si : ils doivent se prostituer pour survivre. Je lis sous la plume de M. Soral qu’il voudrait un partage de la richesse et du travail. Or ce partage est déjà effectué : les riches se partagent la richesse et les pauvres se partagent le travail. Regardez les sauvages, s’il en reste. Chez eux il n’y a ni richesse ni travail. Chez eux « la production », aimerait à dire M. Soral, est une affaire collective. Ils ne savent pas ce que c’est que d’avoir des besoins et donc de les satisfaire.
Durkheim dit que la division sociale du travail produit la solidarité. C’est une grossière erreur. La solidarité existe fondamentalement chez les sauvages à tel point qu’ils l’ignorent puisqu’ils vivent dedans. Ce que produit la division sociale du travail, ce n’est pas la solidarité, c’est la séparation. Grâce à la division sociale du travail telle que nous la connaissons aujourd’hui, les hommes sont totalement solidaires (ils vont peut-être étouffer dans leurs pets y compris ceux qui n’ont jamais pété, bien fait) mais totalement séparés. Ici aussi « la production » est une affaire collective mais elle se fait au prix de la séparation totale. Vous êtes totalement séparé de votre boucher ; de plus, sa main, bien visible, ne quitte jamais le couteau à désosser.
Une autre erreur de M. Camus, c’est que l’argent aux mains des riches n’est pas l’argent que les pauvres dépensent, c’est l’humanité même : les riches demeurent des pauvres mais ils disposent, et eux seuls, de l’humanité. L’aliénation c’est ça. C’est l’humanité aux mains des riches, c’est à dire dans de mauvaises mains, des mains de pauvres (qu’as tu fait de ton talent ?). Le prix de l’argent ce n’est pas l’intérêt, c’est l’aliénation de l’humanité, l’humanité dans de mauvaises mains. Le prix de l’argent c’est la privation de l’humanité pour tous, y compris pour les riches qui ne sont plus que de petits bourgeois (M. Camus est optimiste, les bourgeois ont toujours été petits — pas du temps d’Henry IV évidemment mais du temps de Guizot —. Mes sources : Tocqueville, Balzac, Flaubert, Baudelaire).
Enfin, M. Camus soutient qu’ailleurs n’existe plus, qu’il n’y a plus d’ailleurs. Mais si, mais si puisqu’il existe un émir de l’extérieur et que New York fut bombardée. Les musulmans ne sont pas encore des petits bourgeois, du moins pas tous. La terre de l’extérieur existe et les WASP s’appliquent à l’anéantir. Les protestants voudraient que les musulmans deviennent de petits bourgeois. La démocrachie partout.
L’idéologie américaine →
les méfaits
de l’individualisme méthodique
Je lis de defensa et il me vient l’idée suivante : le crime de ce monde est qu’il est dirigé par la psychologie et non par la raison, quoi que prétende le crétin Weber. Qu’il crève donc, ce monde. Ce n’est pas à l’égoïsme de son boucher qu’Adam Smith fait appel, mais, ce faisant, à sa psychologie. La psychologie des bouchers ne peut mener qu’à la boucherie. Isn’t it ? Bien fait, monde crapuleux.
Dieu n’existe pas, ce qui ne l’empêche pas de bombarder New York le plus tranquillement du monde. Le grand pompeur a beau frapper le sol de son pied, cela ne changera rien. La religion est sainte.
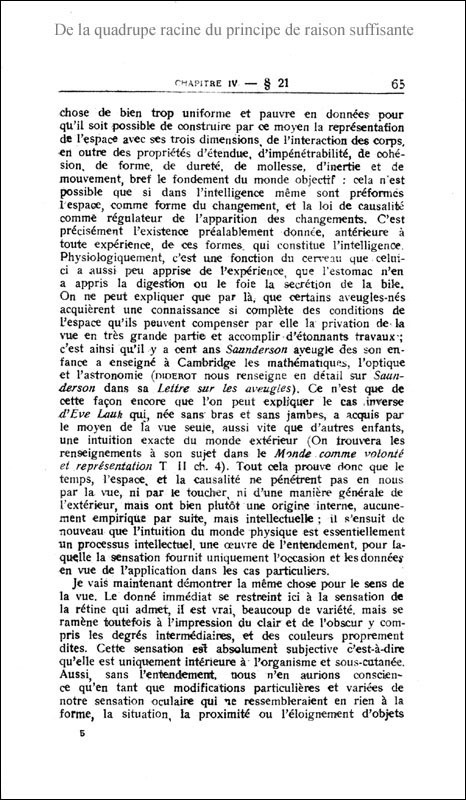
De l’ère géopolitique à l’ère psychopolitique par
un lecteur de Debord →
|
Je lis au hasard : « Aussi Marx est-il amené à penser que les conditions économiques et matérielles déterminent l’anatomie d’une société. Et ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine la réalité, mais c’est la réalité sociale qui détermine leur conscience. » Oui, c’est excellent à ceci près que la réalité sociale n’est ni économique, ni matérielle et les conditions économiques et matérielles ne sont aucune condition. La conscience des hommes est une affaire collective, mais personne n’a jamais avancé d’un chouilla sur cette question.
La valeur n’est pas une égalité.
La valeur n’est pas une
fonction.
La valeur n’est pas une identité.
La valeur n’est pas une
proportion.
La valeur n’est pas un
rapport.
La valeur n’est pas une
grandeur.
La valeur n’est pas une
dimension.
La valeur n’est pas une
mesure.
La valeur n’est pas un
nombre.
La valeur n’est pas une
quantité.
L’expression « il vaut
mieux… » n’a rien à voir avec la valeur. Elle signifie : « il
est préférable de… »
J’ai fait ce petit récapitulatif parce que j’ai lu un
extrait de Bastiat qui disait qu’on ne pouvait pas additionner ou soustraire de
valeur etc. Je fus bien surpris puisque je ne disais rien d’autre dans le
§ 19 de mon Enquête de 1976. Quelle raison Bastiat donnait-il à
cela : on ne pouvait additionner ou soustraire de valeur parce que la
valeur était un rapport. Je compris le terme rapport au sens de Lebesgue,
c’est à dire de mesure. Pour Lebesgue une mesure est le rapport de deux
grandeurs et ce rapport est un nombre. Il condamne la distinction faites par
les professeurs de son époque entre rapport et nombre. Donc, qu’est-ce qui
empêche d’additionner deux valeurs si elles sont des rapports, c’est à dire des
nombres ? Les nombres sont fait précisément pour ça, être additionnés et
soustraits ce que sait très bien le fabriquant parce qu’il calcule ses prix de revient par addition.
Mais le gaillard ne l’entendait pas comme ça. Il faut lire ce genre d’imbécile
vertigineux qui fit les délices de Hayek, Reagan, Thatcher. Il faut lire les
textes, même les textes des imbéciles.
Toutes
les occurrences du terme « économie » dans l’œuvre de
Marx
Manque le Livre II du Capital : — Band II. Der Zirkulationsprozeß des Kapitals →
|
Il est bien dommage que Marx n’ait pas pu lire Valeurs et monnaies de Turgot, et pour cause. Voici tout ce que j’ai trouvé comme références de Marx à Turgot et c’est bien peu : Recherche sur : site:http://www.marxists.org/francais/marx/works Turgot Le
Capital, livre I, 3e
section, chapitre 7, note 5 Le
moyen de travail est une chose ou un ensemble de choses que l’homme interpose
entre lui et l’objet de son travail comme constructeurs de son action. Il se sert
des propriétés mécaniques, physiques, chimiques de certaines choses pour les
faire agir comme forces sur d’autres choses, conformément à son but [3].
Si nous laissons de côté la prise de possession de subsistances toutes
trouvées la cueillette des fruits par exemple, où ce sont les organes de
l’homme qui lui servent d’instrument, nous voyons que le travailleur s’empare
immédiatement, non pas de l’objet, mais du moyen de son travail. Il convertit
ainsi des choses extérieures en organes de sa propre activité, organes qu’il
ajoute aux siens de manière à allonger, en dépit de la Bible, sa stature
naturelle. Comme la terre est son magasin de vivres primitif, elle est aussi
l’arsenal primitif de ses moyens de travail. Elle lui fournit, par exemple,
la pierre dont il se sert pour frotter, trancher, presser, lancer, etc. La terre
elle-même devient moyen de travail, mais ne commence pas à fonctionner comme
tel dans l’agriculture, sans que toute une série d’autres moyens de travail
soit préalablement donnée [4].
Dès qu’il est tant soit peu développé, le travail ne saurait se passer de
moyens déjà travaillés. Dans les plus anciennes cavernes on trouve des
instruments et des armes de pierre. A côté des coquillages, des pierres, des
bois et des os façonnés, on voit figurer au premier rang parmi les moyens de
travail primitifs l’animal dompté et apprivoisé, c’est à dire déjà
modifié par le travail [5].
L’emploi et la création de moyens de travail, quoiqu’ils se trouvent en germe
chez
quelques espèces animales, caractérisent éminemment le travail humain. Aussi
Franklin donne t il cette définition de l’homme : l’homme est
un animal fabricateur d’outils « a toolmaking animal ». Les débris
des anciens moyens de travail ont pour l’étude des formes économiques des
sociétés disparues la même importance que la structure des os fossiles pour
la connaissance de l’organisation des races éteintes. Ce qui distingue une époque
économique d’une autre, c’est moins ce que l’on fabrique, que la manière de
fabriquer, les moyens de travail par lesquels on fabrique [6].
Les moyens de travail sont les gradimètres du développement du travailleur,
et les exposants des rapports sociaux dans lesquels il travaille. Cependant
les moyens mécaniques, dont l’ensemble peut être nommé le système osseux et
musculaire de la production, offrent des caractères bien plus distinctifs
d’une époque économique que les moyens qui ne servent qu’à recevoir et à
conserver les objets ou produits du travail, et dont l’ensemble forme comme
le système vasculaire de la production, tels que, par exemple, vases,
corbeilles, pots et cruches, etc. Ce n’est que dans la fabrication chimique
qu’ils commencent à jouer un rôle plus important. ___________________ 5. Dans
ses Réflexions sur la formation et la distribution des richesses,
1776, Turgot fait parfaitement
ressortir l’importance de l’animal apprivoisé et dompté pour les
commencements de la culture. Quelques
écrivains, les uns comme défenseurs de la propriété foncière contre les
attaques des économistes bourgeois, les autres, tels que Carey, dans le but
de substituer aux antagonismes de la production capitaliste un système d’«
harmonies », ont essayé d’identifier la rente, l’expression économique de la
propriété foncière, avec l’intérêt ; par là se serait apaisée l’opposition
entre les propriétaires fonciers et les capitalistes. Le procédé inverse fut
suivi au début de la production capitaliste. A cette époque la propriété
foncière représentait encore, dans la conception populaire, la forme
primitive de la propriété privée, tandis que l’intérêt du capital était
méprisé et considéré comme un produit de l’usure. C’est alors que Dudley
North, Locke et d’autres intervinrent et assimilèrent l’intérêt du capital à
la rente foncière, en même temps que Turgot se basait sur l’existence de cette dernière pour
justifier l’intérêt. Les écrivains modernes oublient, — sans compter que la
rente foncière peut exister et existe pure, sans addition de l’intérêt du
capital incorporé à la terre — que le propriétaire foncier qui profite de ce
capital, non seulement prélève l’intérêt d’une avance qui ne lui a rien
coûté, mais devient gratuitement propriétaire de ce capital lui-même. Le Capital,
« Un Chapitre inédit », note 4 Comme
on l’a vu, la valeur d’échange de la force de travail est payée en
même temps que le prix des moyens de subsistance nécessaires, étant données
les habitudes de chaque société, afin que l’ouvrier exerce en général sa
capacité de travail avec le degré adéquat de force, de santé et de vitalité,
et perpétue sa race [4]. ___________________ 4. Petty
détermine la valeur du salaire journalier d’après la valeur de ce dont
l’ouvrier a besoin « pour vivre, travailler et se reproduire ».
Cf. Political Anatomy of Ireland, édit. de Londres, 1672,
p. 69. Cité d’après Dureau de la Malle. « Le
prix du travail se compose toujours du prix des choses absolument nécessaires
à la vie ». Le travailleur n’obtient pas un salaire suffisant
« toutes les fois que le prix des denrées nécessaires est tel que son
salaire ne lui permet pas d’élever conformément à son humble rang une
famille telle qu’il semble que ce soit le lot de la plupart d’entre eux d’en
avoir. » Cf. Jacob
Vanderlint, Money Answers all Things, Londres, 1743, p. 19. « Le
simple ouvrier, qui n’a que ses bras et son industrie, n’a rien qu’autant
qu’il parvient à vendre à d’autres sa peine... En tout genre de travail, il
doit arriver, et il arrive en effet, que le salaire de l’ouvrier se borne à
ce qui lui est nécessaire pour lui procurer sa subsistance. » Cf. Turgot, Réflexions sur la formation et
la distribution des richesses, 1766, Œuvres, édit. Daire, tome I, p. 10. « Le
prix des subsistances nécessaires à la vie est en réalité ce que coûte le
travail productif. » Cf.
Malthus, An Inquiry into the nature of Rent, etc. Londres,
1815, p. 48 note. [Cette partie de la note se retrouve dans le livre I du Capital,
tome IL p. 81.] « D’une
étude comparée des prix du blé et des salaires depuis le règne d’Edouard III,
c’est-à-dire depuis 500 ans, il ressort que, dans ce pays, le revenu
quotidien de l’ouvrier s’est tenu plus souvent au-dessous qu’au-dessus d’une
mesure de blé d’un quart de boisseau. Cette mesure de blé forme une sorte de
moyenne, et plutôt supérieure, autour de laquelle les salaires exprimés en
blé oscillent selon l’offre et la demande. » Cf. Malthus, Principles of Political Economy,
2° édit., Londres, 1836, p. 254. « Le
prix naturel de n’importe quel objet est celui... que l’on donne à sa
production... Le prix naturel du travail consiste en une quantité de denrées
nécessaires à la vie et de moyens de jouissance telle que la requièrent la
nature du climat et les habitudes du pays pour entretenir le travailleur et
le mettre en état d’élever une famille, pour que le nombre des travailleurs
demandés sur le marché n’éprouve pas de diminution... Le prix naturel du
travail, bien qu’il varie sous des climats différents et en fonction des
niveaux variables de la progression nationale, peut, en n’importe quel moment
et lieu donnés, être considérés comme pratiquement stationnaire. » Cf. Torrens, An Essay of the
external Corn Trade, Londres, 1815, p. 62. [Le lecteur retrouvera
une partie de cette dernière citation au livre I du Capital, tome I,
pp. 174-175 note.] A cela, il faut ajouter, Le Capital, Livre II : Livre
II, tome IV, Édition socialiniennes /175/ La différence entre les deux genres d’avances apparaît seulement quand l’argent avancé se trouve converti en éléments du capital productif. C’est une différence qui existe uniquement au sein du capital productif. Aussi Quesnay n’a-t-il pas l’idée de ranger l’argent ni parmi les avances primitives ni parmi les avances annuelles. En tant qu’avances de la production, — c’est-à-dire en tant que capital productif, — les unes et les autres s’opposent aussi bien à l’argent qu’aux marchandises qui se trouvent sur le marché. De plus, Quesnay ramène correctement la différence entre ces deux éléments du capital productif à leur manière différente d’entrer dans la valeur du produit fini, donc à la manière différente dont leur valeur est mise en circulation avec le produit, donc à la manière différente dont s’opère leur remplacement ou leur reproduction, la valeur de l’un se remplaçant en entier tous les ans, celle de l’autre dans des périodes plus longues et par fractions1. ___________________ 1. Voir, pour QUESNAY, l’Analyse du Tableau économique (Physiocrates, Édition Daire, 1re partie, Paris, 1846). On y lit, par exemple « Les avances annuelles consistent dans les dépenses qui se font annuellement pour le travail de la culture ; ces avances doivent être distinguées des avances primitives qui forment le fonds de l’établissement de la culture » (p. 59). Chez les physiocrates plus récents, les avances sont parfois désignées déjà franchement comme capital : « Capital ou avances » DUPONT DE NEMOURS : Maximes du Dr Quesnay, etc. (DAIRE, Physiocrates, 1re partie, p. 391) ; puis Le TROSNE : « Au moyen de la durée plus ou moins grande /176/ des ouvrages de main-d’œuvre, une nation possède un fonds considérable de richesses Indépendant de sa reproduction annuelle, qui forme un capital accumulé de longue main et originairement payé avec les productions, qui s’entretient et s’augmente toujours. » (DAIRE, 2e partie, p. 928). Turgot emploie déjà plus régulièrement le mot capital au lieu d’avances et identifie encore davantage les avances des manufacturiers avec celles des fermiers (TURGOT : Réflexions sur la formation et la distribution des richesses, 1766). * * * /317/ En dehors de cela, le cycle de l’argent, — c’est-à-dire son retour à son point de départ, — pour autant qu’il forme un facteur de la rotation du capital, constitue, par rapport à la circulation de l’argent, un phénomène tout à fait différent, voire opposé 3 : la circulation /318/ exprime seulement qu’en passant d’une main à l’autre, l’argent s’éloigne de plus en plus de son point de départ. Cependant l’accélération de la rotation implique par le fait même celle de la circulation. ___________________ 3. Tout en confondant encore les deux
phénomènes, les physiocrates sont les premiers a souligner le retour de l’argent à son point
de départ comme forme essentielle de la circulation du capital, comme forme
de la circulation servant d’intermédiaire à la reproduction. « Jetez
les yeux sur le Tableau économique, vous verrez que la classe productive
donne l’argent avec lequel les autres classes viennent lui acheter des
productions, et qu’elles lui rendent cet argent en revenant l’année suivante
faire chez
elle les mêmes achats... Vous ne voyez donc ici d’autre cercle que celui de la
dépense suivie de la reproduction, et de la
reproduction suivie de la dépense ; cercle qui est parcouru par la
circulation de l’argent qui mesure la dépense et la reproduction. » /318/
(QUESNAY : Problèmes économiques, chez Daire : Physiocrates, I, p. 208). — « C’est cette avance et cette
rentrée continuelle des capitaux qu’on doit appeler la circulation de
l’argent, cette circulation utile et féconde qui anime tous les travaux de
la société, qui entretient le mouvement et la vie dans le corps politique et
qu’on a grande raison de comparer à la circulation du sang dans le corps animal. »
(TURGOT : Réflexions, etc., Éd. Daire, I, p. 45.) Livre
II, tome V, Édition socialiniennes /16/
Dans l’analyse du procès de reproduction, Adam Smith1 fait un pas
en arrière. C’est d’autant plus frappant que, d’ordinaire, il ne se borne pas
à développer des analyses justes de Quesnay, par exemple ses « avances
primitives » et « avances annuelles » qu’il généralise en capital
« fixe » et capital « circulant »2, il retombe même par endroits
tout à fait dans les erreurs des physiocrates. Pour démontrer par exemple que
le fermier produit plus de valeur que n’importe quelle autre espèce de
capitalistes, il dit : « Il n’est pas de capital qui, à grandeur égale,
mette en mouvement une plus grande quantité de travail productif que celui du
fermier. Non seulement ses domestiques, mais ses bêtes de travail aussi sont
des ouvriers productifs. [Joli compliment pour les domestiques !] En
agriculture, la nature travaille aussi, à côté des hommes ; et
quoique son travail ne coûte aucune dépense, ce qu’elle produit n’en a
pas moins sa valeur propre, aussi /17/… ______________________ 2. Sur ce point aussi, quelques physiocrates,
surtout Turgot, lui avaient frayé la voie. Celui-ci emploie déjà plus
fréquemment que Quesnay et les autres physiocrates le mot de capital pour avances
et assimile encore plus les avances ou capitaux des manufacturiers à ceux des
fermiers. Par exemple : « Comme
eux [les entrepreneurs de fabrique], ils [les fermiers, c’est-à-dire les
fermiers capitalistes] doivent recueillir, outre la rentrée de leurs capitaux,
etc. » (TURGOT, (Œuvres, Édition Daire, Paris,
1844, t. I, p. 40.) |
|
La querelle de l’humanisme Il est impossible de s’expliquer l’intensité du débat autour du structuralisme, dans la classe intellectuelle, si l’on y voit une simple controverse sur la méthode dans les sciences sociales : des « questions de méthode », comme disait Sartre en 1961. Et il faut même avouer qu’à première vue le structuralisme semble bien peu fait pour le rôle qu’il va jouer pendant dix ans : évangile bouleversant, vérité subversive, percée audacieuse, première mise en échec du logos occidental et de son ethnocentrisme... Loin de poser au cavalier de l’Apocalypse, le structuralisme s’est d’abord présenté lui-même, plus modestement, comme un rationalisme élargi. Tel est le but que se reconnaît Lévi-Strauss : « une sorte de super-rationalisme [Tristes tropiques, Plon, 1955, p. 50.] » (expression d’ailleurs ambiguë, puisqu’on ne sait pas s’il veut dire « rationalisme plus puissant encore » ou bien « quelque chose comme un surréalisme de la science »). C’est là ce qu’en retenait Merleau-Ponty en 1959, dans un article où il commentait les travaux de Lévi-Strauss « La tâche est donc d’élargir notre raison pour la rendre capable de comprendre ce qui en nous et dans les autres précède et excède la raison » [Signes, p. 154]. On l’a vu, c’est exactement ce que Merleau-Ponty attendait, en 1946, d’une interprétation de Hegel. La mission d’une raison élargie est de comprendre l’irrationnel, lequel s’offre à nous principalement sous deux espèces : parmi nous, le fou (qui « excède la raison ») et hors de chez nous le sauvage (qui la « précède »). D’où l’attention privilégiée dont bénéficient la psychanalyse (qui, avec /125/ son concept d’inconscient, a installé la déraison chez ceux qui se croyaient sains d’esprit) et l’anthropologie sociale (qui étudie les comportements archaïques des « primitifs »). Si ces sciences peuvent nous faire comprendre l’irrationnel du rêve, du délire, de la magie ou du tabou, la raison du mâle adulte occidental subit une défaite, mais c’est au profit d’une raison plus universelle. Rien de plus conforme à ce perpétuel dépassement de la raison par elle-même que le structuralisme, ce dernier étant finalement la recherche d’invariants universels. Le structuraliste n’est pas autre chose que le représentant, dans le domaine anthropologique, des exigences de la science : de même que la science du mouvement (la physique) est la connaissance de ce qui, dans un changement, ne change pas, à savoir les rapports invariants entre les variations de la position du mobile dans l’espace et de la date de ces positions dans le temps, de même la science de l’homme est la connaissance de ce qui reste constant dans toute variation possible, la variation correspondant ici au dépaysement, au voyage dans l’exotique ou dans l’archaïque. Où voit-on, en tout ceci, matière à querelle ? C’est que, derrière ce qui semble être une controverse savante sur les vertus de telle ou telle méthode, il y a un enjeu politique, non pas certes pour le pays tout entier, mais pour la classe intellectuelle. La sémiologie, comme on l’a
vu, déplace toutes les questions vers l’analyse des discours, et elle fait
venir au premier plan la relation de l’émetteur au code, ou, comme disent les
lacaniens, du sujet au signifiant. Il en résultait que l’origine du sens ne
pouvait plus être placée là où le phénoménologue croyait la trouver — dans
l’auteur du discours, dans l’individu qui croit s’exprimer — mais qu’elle
était dans le langage lui-même [Frege avait déjà
répondu : dans le monde, les pensées sont saisies dans le monde].
Soit un récit mythique : le sens de ce mythe n’est pas à chercher dans
le « vécu » du récitant, et il ne faut pas le lire comme
l’expression d’une « conscience mythique ». Le mythe est un
récit : la forme narrative de cette histoire n’est pas inventée par le
narrateur, mais elle préexiste à la narration et peut être considérée comme
un code permettant d’émettre des messages mythiques. Pour déterminer le sens
du mythe, il faut donc le comparer aux autres mythes circulant dans le même
ensemble culturel et en reconstituer le code. Le narrateur subit les contraintes
de ce /126/ code, son récit ne doit pas grand-chose à sa
fantaisie. C’est ainsi que le sens de ses personnages et de leurs aventures
est déterminé à l’avance par la grammaire du récit dans sa province
culturelle : et si, par exemple, des oppositions telles que
« géant/nain » ou « princesse/bergère » sont reçues comme
significatives dans ce code, la taille et la profession des personnages ne
sont plus libres. Par conséquent, le récitant du mythe ne fait qu’actualiser
des possibilités inhérentes au code, au système signifiant auquel il se
soumet pour parler, et c’est bien en fin de compte la structure qui décide de
ce qui peut — et parfois de ce qui doit — être dit en telle occasion. Les
structures décident et non l’homme ! L’homme n’est plus rien ! Telle est la leçon que l’opinion a retenue
des recherches de l’anthropologie structurale : du moins, si on lisait
les commentaires scandalisés des ci-devant « humanistes ». L’essentiel, toutefois, est
ailleurs. On sait que dans son livre Psychologie
des foules et analyse du moi, Freud
consacre un chapitre à deux institutions qu’il appelle « foules
artificielles » : l’Eglise catholique et l’armée. Comment
expliquer, se demande Freud, la cohésion de ces associations qui résistent
aux épreuves du temps (persécutions, défaites, etc.) ? Chacun sait, bien
entendu, où les organisations de masse puisent leur force : comme le
veut l’adage, « la discipline fait la force des armées ». Mais ce
qui étonne Freud est la docilité des individus qui se soumettent à cette
discipline, sacrifiant leur indépendance et parfois leur vie. Il estime que l’amour
est la seule puissance capable
d’amener l’individu à mépriser ainsi ses intérêts personnels : la
cohésion des « foules artificielles » serait donc libidinale. Les
soldats et les fidèles aiment leurs chefs et fraternisent dans cette passion
qui leur est commune. Lacan, qui a plusieurs fois commenté ces
pages, a fait observer que ce lien d’amour entre les fidèles de l’Eglise ou
les camarades du champ de bataille était institué par le discours [Voir « Situation de la psychanalyse en
1956 », Ecrits, p. 475.]. Le lien est symbolique : les institutions — Eglises, armées — se
maintiennent dans l’exacte mesure où elles maintiennent les symboles qui les
fondent, c’est-à-dire un système signifiant. Dans ces communautés organisées,
l’orthodoxie /127/ équivaut à l’observance stricte des formes :
on doit parler d’une certaine façon, employer les mots
« consacrés ». En toute orthodoxie, décisive est l’identité des
signifiants : après cela, chacun est bien libre de les entendre comme il
peut. Ainsi, comme le pensait Mallarmé, toucher
au langage, aux formes signifiantes, ce serait subvertir la communauté [« On a touché au vers » (La
Musique et les Lettres).] Lacan dira, dans son séminaire de 1970, que le discours fonde le lien social. Cette formule est sans doute la
meilleure expression qui ait été donnée de ce qui se jouait dans les débats
structuralistes. Car on remarquera ceci : en 1921, Freud citait en exemple l’armée allemande et l’Eglise romaine ;
ces exemples étaient à l’époque les plus naturels (bien que Freud y suggère
que les organisations politiques, telles le « parti socialiste »,
pourraient remplacer dans l’avenir les organisations religieuses) ;
mais, dans la France de 1960, les « foules artificielles »
auxquelles un intellectuel peut avoir affaire seraient plutôt le parti
communiste (ou encore les petits groupes d’extrême gauche qui rêvent de lui
ravir sa position de « direction révolutionnaire du prolétariat »)
et les différentes sociétés de psychanalyse. La thèse principale des sémiologues acquiert, dans ce contexte, une signification politique. Elle met en cause les pouvoirs qu’exercent ces institutions sur leurs sujets. S’il est vrai que le signifiant soit extérieur au sujet, alors les discours politiques de la société industrielle sont analogues aux récits mythiques des prétendus, primitifs. Dans les deux cas, un langage précède les individus et soutient la communauté, il permet à chacun de raconter ce qui lui arrive, non pas sans doute tel que cela est arrivé, mais tel que les autres peuvent l’entendre. La satisfaction que le militant éprouve à entendre les allocutions de ses chefs ou à lire le quotidien communiste l’Humanité est comparable au soulagement que ressent l’Indien malade soigné par le shaman de la tribu que cite Lévi-Strauss dans son article sur « l’efficacité symbolique [Anthropologie structurale, I, ch. X] ». Dans les deux cas, il s’agit pour un individu d’être réintégré dans sa communauté par les effets du symbole. Lévi-Strauss, /128/ qui de son côté compare le shaman indien au psychanalyste des sociétés occidentales, conclut en ces termes : « Le shaman fournit à sa malade un langage,
dans lequel peuvent s’exprimer immédiatement des états informulés, et
autrement informulables. Et c’est le passage à cette expression verbale (qui
permet, en même temps, de vivre sous une forme ordonnée et intelligible une
expérience actuelle, mais, sans cela, anarchique et ineffable) qui provoque
le déblocage du processus physiologique, c’est-à-dire la réorganisation,
dans un sens favorable, de la séquence dont la malade subit le
déroulement » [Ibid., p. 218]. Le théorème sémiologique sur l’extériorité
du signifiant a donc un corollaire politique : les « idéologies
politiques », comme elles se désignent elles-mêmes, de nos sociétés sont
très exactement des mythes ; et leur
efficacité symbolique (confiance des fidèles, adhésion des masses) ne
garantit nullement leur adéquation à la réalité dont elles prétendent parler.
Lévi-Strauss a explicitement tiré cette conséquence : « Rien ne
ressemble plus à la pensée mythique que l’idéologie politique [Ibid., p. 231] ». Un mythe est le récit d’un événement
fondateur, d’un épisode privilégié qui est à la fois dans un certain temps
(les origines) et de tout temps (car les jours de fête sont consacrés à les
répéter). Telle est justement, comme l’observe Lévi-Strauss, la place que
tient en France un événement tel que la révolution française : dans
l’idéologie politique générale, aussi bien que dans la pensée, par exemple,
de Sartre telle qu’on la trouve dans la Critique de la raison dialectique.
Aussi cet ouvrage est-il « un document ethnographique de premier ordre,
dont l’étude est indispensable si l’on veut comprendre la mythologie de notre
temps » [La pensée sauvage,
p. 330.] La
notion même d’un « sens de l’histoire » s’obscurcit avec la
sémiologie. Merleau-Ponty avait parlé, non sans nostalgie, de ces
« points sublimes », de ces « moments /129/
parfaits » où chaque individu est initialement accordé au cours du
monde, éprouve l’histoire universelle comme son histoire [Les Aventures de la dialectique, p. 99
et 122]. L’ethnologue
n’a pas de peine à reconnaître dans ces instants privilégiés d’effervescence
collective l’équivalent du temps de fête pendant lequel les communautés
archaïques ravivent leur unanimité dans une répétition rituelle du mythe
fondateur. Lévi-Strauss conclut que le sens vécu de l’histoire est
inévitablement son sens mythique [La
pensée sauvage, p. 338]. Ainsi, mettant à jour
l’hétérogénéité du signifiant à l’expérience vécue, la sémiologie impliquait
une leçon politique. Elle montrait que l’emprise des institutions sur les
individus se ramène à la domination d’un langage. Elle anticipait, à sa
façon, sur les émeutes de mai 68 en montrant qu’un discours dominant
n’impose pas tant certaines vérités (des dogmes, des « signifiés »)
qu’un langage commun (des formules, des « signifiants ») par lequel
l’opposant lui-même doit passer pour faire état de son opposition. Un épisode
tel que celui de la guérison d’un malade par un sorcier, ou d’une hystérique
par un psychanalyste, montre que les questions essentielles se jouent aux
frontières du langage dominant. D’une part, le malade que soigne le sorcier
croit aux mythes et aux traditions de sa tribu. Mais, d’autre part, il
éprouve dans son corps une souffrance intolérable et incongrue. Le problème
que le sorcier est chargé par la communauté de résoudre est posé par ce
désaccord entre le discours de la communauté (mythe) et l’expérience de
l’individu. La douleur est ici cet élément rebelle, insensé, inacceptable,
dont le malade ne sait que faire et par lequel il est exclu de la vie
commune, « mais que, par l’appel au mythe, le shaman va replacer, dans
un ensemble où tout se tient [Anthropologie structurale, I,
p. 218] ». Apprivoiser
l’élément brutal de l’existence, assimiler l’hétérogène, donner sens à
l’insensé, rationaliser l’incongru, bref, traduire l’autre dans la langue du
même, c’est donc là ce qu’opèrent les mythes et les idéologies. La sémiologie
ouvre ainsi la voie à une étude critique des discours dominants en Occident
pour y retrouver, sous les solutions apaisantes et les allures rationnelles
« où tout se tient », les /130/ conflits indicibles. Le
langage commun, les formes à prétention universalisante, les communautés
unanimes sont mensongères. La génération de 1960 renonce aux idéaux d’un
« nouveau classicisme » et d’une « civilisation
organique » que Merleau-Ponty défendait en 1946. Elle ne croit plus que
la tâche du siècle soit d’intégrer l’irrationnel à une raison élargie. La
tâche maintenant est la déconstruction de ce qui se montre au principe du
langage dominant l’Occident (la logique de l’identité) et la critique de
l’histoire considérée désormais comme un mythe, c’est-à-dire une solution
efficace, mais sans vérité, du conflit entre le même et l’autre. Il est
commode de distinguer ces deux aspects : la critique de l’histoire, la critique
de l’identité. Bien que les têtes politiques soient plus à l’aise dans le premier
genre, et les têtes métaphysiques dans le second, il va de soi que la plupart
des écrits notables de la période que je vais maintenant considérer
contiennent en proportion diverse des éléments appartenant à l’un et l’autre
genre. C’est étonnant. Quand Descombes en parle, c’est
plein de sens, je dirais même plein de bon sens. Avec ça on est à pied
d’œuvre. Le terme « économie » est un signifiant flottant au même
titre que « manitou ». Elles souffrent les pauvres bêtes et elle ne
peuvent même plus nommer leur souffrance (un thème des situationnistes). Les
shah men en costard de la télévision leur psalmodient un signifiant flottant
(un mot vide de sens, c’est à dire sans référent — le référent n’est pas le
sens mais il en est la condition nécessaire : pas de référent, pas de
sens ; le signifiant flotte, il
ne sait où se poser) afin qu’elles puissent nommer leur souffrance.
C’est un cadeau empoisonné. Le but est que les ignorants continuent d’ignorer
qu’ils sont ignorants. Ils croient qu’ils savent au lieu de savoir qu’ils
ignorent. Cela dit, la langue, contrairement aux si vils, est innocente. Elle
oppresse aussi peu que l’eau n’oppresse le poisson. Nous vivons dans un savoir,
ainsi que le voulait Hegel. L’oppression a lieu dans le savoir mais la
libération aussi. Les inventions ont lieu dans la langue. C’est bien
d’inventer que furent incapable les charlatans de la structure. L’un d’eux
proféra, jadis, que la langue était fasciste. « Fasciste » est
aussi un signifiant flottant au même titre que « Le Pen ». Les shah
men lâchent ces bouts de gras aux foules canines. Je l’avais bien vu :
Nabe en 1985 était en légitime défense. Il ne voulait pas mordre dans le bout
de gras du jour avec le reste de la foule canine. La télévision, la TSF sont
un bombardement permanent de signifiants flottants. Avec ce ramdam, on ne
s’entend plus penser. Je comprend en lisant Descombes que ces fumiers de
charlatans de la structure ont chié sur quelque chose de très intéressant et
l’ont neutralisé — en service commandé. Comme le note Descombes dans un
ouvrage plus récent, ils proclamaient comme des bouleversement mondiaux (la
fin de l’homme, la fin du sujet) de simple aménagements conceptuels, foireux
qui plus est. |
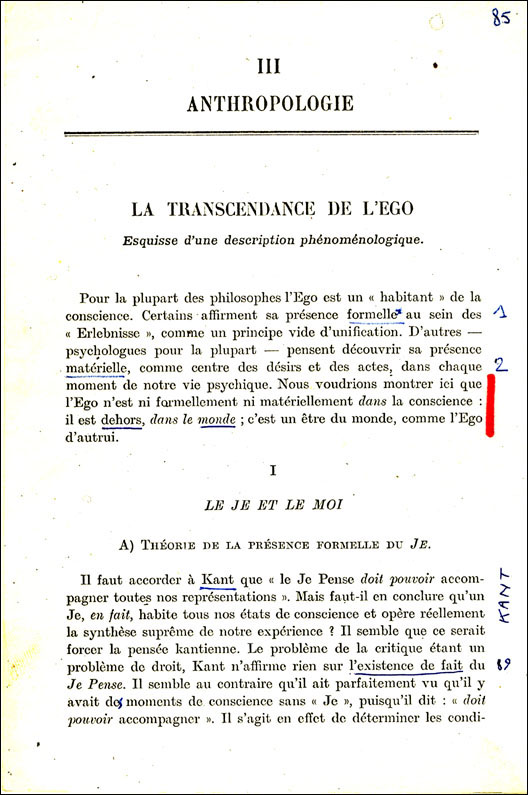
Recherches philosophiques, in 4°, tome 6 (1936-1937)
|
/211/…
« La vérité qu’offrait le savoir de la théorie révolutionnaire n’était
qu’un idéal. Elle n’était donc pas du tout la vérité, mais seulement l’expression d’un désir de vérité. Elle procédait
de la même croyance en la vérité que la religion*. » Arrivés
en ce point, nous voudrions pouvoir interrompre un instant Lyotard et lui
dire : Peut-être était-ce cette vérité du militant qui était mal
fondée ; un désir lui a fait recevoir les énoncés marxistes comme vrais,
mais peut-être, tout simplement, n’étaient-ils pas vrais. Hélas ! Il ne
nous entend pas, déjà sa course l’a porté plus loin, il poursuit de plus
belle et franchit d’un seul bond toute la distance qui sépare sa désillusion
d’une polémique contre la vérité comme telle. De l’observation : cette vérité
n’était que l’expression d’un désir, il passe à l’interprétation : le
désir qui s’exprimait dans cette prétendue « vérité », était le
désir de vérité. Nous demandons à voir... Mais il en résulte ceci : s’il
y avait une vérité, elle serait donc hégélienne ou, si l’on préfère, marxiste.
Si le marxisme n’est pas vrai, ce n’est pas parce qu’il est faux, mais parce
que rien n’est vrai. » *. Lyotard. Economie libidinale, « Le désir nommé Marx ». Ce qui est étonnant, c’est que lorsque Descombes parle du galimatias de ces charlatans, c’est très clair et très bref. Passage intéressant sur Merleau-Ponty :
|
|
« Pour moi, la rencontre [avec Dumont] date de son livre sur Marx, Homo Aequalis (1977). J’avais à l’époque déposé un sujet de thèse sur la naissance de la sociologie, avec l’idée d’étudier le conflit entre le concept de société tel qu’il était introduit par les fondateurs de la sociologie, à partir d’Auguste Comte, et puis le concept ordinaire de société, celui des économistes*. Quand j’ai découvert le livre de Dumont, j’ai constaté que tout mon sujet était déjà traité beaucoup mieux que je n’aurais pu le faire. La grande thèse de ce livre c’est qu’il faut, contrairement à l’opinion commune, mettre Marx du côté du concept individualiste de la société, et pas du côté sociologique. Le marxisme se veut fondé sur une “critique de l’économie politique”, mais ce n’est pas une critique pleinement sociologique des présupposés individualistes de l’économie politique. À certains égards, Marx porte à son comble le principe de l’idéologie économique, c’est-à-dire de la conception individualiste du social. Son analyse de l’idéologie moderne devait conduire Dumont à une nouvelle lecture de l’histoire politique postrévolutionnaire, en particulier à une autre interprétation des phénomènes nationaux et des guerres. Et c’est ce que j’avais pressenti, comme le suggérait le titre de mon compte rendu : “Pour elle un Français doit mourir.” (Critique, n° 366, novembre 1977) Le problème qui a occupé sa pensée jusqu’à la fin, c’est précisément la crise européenne du XXesiècle, les guerres et leurs suites totalitaires, ce qu’il appelle les “malheurs de la démocratie” ».
* Qu’est ce que ce concept de société des économistes ? Eh bien ! c’est la fameuse économie qui n’est, fort heureusement, qu’un concept, au sens de vue de l’esprit. Ce concept fut porté à son summum par Marx et Staline tenta de le réaliser.
« Par ailleurs, la pensée politique de Castoriadis culminait dans une critique du capitalisme et des régimes libéraux qui, je crois, n’a rien perdu de son actualité. Dans les années 1990, son diagnostic sur ce qu’il tenait à appeler une crise des régimes de démocratie libérale est devenu plus sombre. C’était selon lui une erreur capitale de minimiser la gravité de ce qu’il appelait “la montée de l’insignifiance” ou d’y voir comme un régime normal de croisière pour une société fondée sur la seule définition de “libertés négatives” et de “règles procédurales” pour la vie commune. Castoriadis jugeait, me semble-t-il, que la grande contradiction du système était désormais dans les conditions de sa reproduction. Le capitalisme, qui avait été un système reposant sur les vertus de l’entrepreneur et de l’innovateur, n’était plus animé que par un projet de maîtrise illimitée des ressources disponibles en vue d’une consommation elle aussi illimitée. Ce système tend, disait-il, à détruire les fondements humains de sa propre reproduction. De même que notre mode de vie nous amène à dépenser les ressources naturelles que nous ne renouvelons pas, de même le système politico-économique qui a succédé au capitalisme classique se reproduit grâce à des “types anthropologiques” qui viennent d’époques plus anciennes. Le système se reproduit pour autant qu’il peut compter sur des gens dont les valeurs ne sont pas celles du système et s’expriment dans des vertus désuètes [qualifiées de moisies par l’américano-parisianisme] du point de vue de ce système : intégrité, amour du travail bien fait, sens des responsabilités historiques à long terme, etc. »
Tout occupé à brutaliser ses « ressources humaines », le système détruit les ressources de paléo-humanité qui existent encore et qui seules, permettent au système de fonctionner. Cela s’appelle scier la branche sur laquelle on est assis. Déjà de féroces Arabes bombardent New York et des Touaregs razzient Paris.
« Si maintenant on pose la même question au niveau de la société tout entière, le recours à l’autoposition a quelque chose d’inquiétant ou de mystificateur. On nous dit qu’une société libre est celle qui opère une autoposition, donc une position de soi instantanée. Mais quelle forme pourrait prendre cette autopunition ? Une réunion du peuple souverain, qui, d’un seul Fiat, se donnerait le pouvoir de se réunir et de se constituer ? Une telle version de l’autoposition serait la négation de l’histoire, et conceptuellement elle est aberrante. En revanche, si la “création social-historique” est comprise comme une sorte d’auto-éducation, alors il s’agit plutôt de l’auto-institution humaine, laquelle est un fait anthropologique capital. C’est ce que j’ai essayé de développer, à la fin du Complément de sujet, en m’appuyant sur Wittgenstein et sa réflexion sur les règles. Les règles sont une œuvre humaine, elles ne sont pas extraites de la Nature, mais on ne peut pas penser leur surgissement comme l’effet d’un acte souverain explicite, accompli en un instant. Ce n’est jamais la première fois qu’on applique les règles. D’ailleurs Castoriadis le dit lui-même nous pouvons aujourd’hui inventer une nouvelle institution, mais nous n’avons jamais à inventer l’idée même d’institution. Et la même chose vaut pour l’humanité empirique. Les groupes historiques peuvent inventer, développer des initiatives, exercer une imagination instituante, mais toujours en s’appuyant sur de l’institué. »
Nous pouvons inventer des règles, mais nous n’avons pas à inventer l’idée de règle.
« Ce qu’a bien noté aussi Durkheim, c’est que plus les affaires sociales deviendront flexibles, négociables, contractuelles, plus il faudra par ailleurs de garanties et de règlements, ce qui veut dire que chaque avancée individualiste exige une intervention accrue des instances sociales. Comme il le dit, tout n’est pas contractuel dans le contrat ! On ne saurait mieux marquer l’écart entre la représentation individualiste des choses et la réalité institutionnelle dans laquelle l’individualisme est concevable. Le discours actuel, qui prétend qu’il n’y a plus de société, plus d’institutions, que tout est devenu flexible, mouvant, etc., est une vieille rengaine, et il fait preuve d’une grande myopie. Que des gens puissent se trouver en face les uns des autres et faire surgir ensemble non pas la guerre, ni le chaos ou la folie, mais simplement des rapports plus informels, cela montre à quel point ils sont déjà modelés, éduqués, socialisés en vue de pouvoir avoir ces rapports informels... »
« Les
gens qui pensent que l’on peut effacer le social pour le remplacer par des
accords contractuels sont en fait des spencériens attardés : il n’y
aurait plus de statuts, mais simplement des contrats d’un bout à l’autre de
qu’il ne faudrait plus appeler la vie sociale, mais peut être des “réseaux”
d’interaction entre des particules humaines [dont Michel “prends l’oseille et tire toi” nous
a déjà donné un avant-goût]. » Quant à l’idée selon laquelle les institutions ont perdu leur fonction normative, cette vue repose sur une erreur philosophique, qui est d’assimiler les institutions à des interdits. Or, cette erreur majeure se retrouve dans des théories opposées, celles qui appellent à liquider les codes rigides du passé, mais aussi celles qui voudraient résister à cette liquidation au nom d’un ordre symbolique. En effet, on nous explique que cet ordre symbolique est construit sur des interdits, qu’il consiste essentiellement dans de grands interdits fondateurs opposés aux désirs indéfinis. Or, justement, les institutions les plus fondamentales ne sont pas des interdits : dans la construction d’une réalité sociale, les interdits et les permissions viennent forcément en second. Ils ne peuvent pas être formulés tant qu’on n’a pas distingué plusieurs espaces : le profane et le sacré, cette famille et les autres, etc. Tout cela doit être déjà identifié, séparé, nommé, par des institutions dont le rôle le plus primitif n’est pas d’interdire, mais de définir. » Définition
et interdiction » J’applique ici au droit, et plus généralement aux
institutions, ce que Wittgenstein dit en prenant l’exemple des règles du
jeu : il ne faut pas dire, “au tennis il n’est pas permis de marquer des
buts », mais “au tennis il n’existe pas de buts”. Si l’on disait “on ne doit
pas le faire, ce n’est pas autorisé”, on suggérerait inévitablement que c’est
là une chose concevable, une chose qu’on pourrait faire, mais que ce ne
serait pas bien de le faire. Quelqu’un pourrait très bien demander : pourquoi
ne pas essayer ? où est le mal ? qui cela dérange-t-il ? Alors
qu’en réalité, on ne peut pas le faire puisque ça n’existe pas. Il n’y a rien qu’on puisse imaginer qui consisterait marquer un but au
tennis. Les levées de tabous évoquées dans les débats contemporains, et notamment
dans le domaine de l’éducation ou de la famille, sont présentées comme des
audaces, des contestations élevées contre des prescriptions immémoriales.
Effectivement, si c’était vraiment d’interdits qu’il s’agissait, on pourrait
avoir cette posture critique, ce discours émancipateur. Pourtant, les règles qui sont
ici mises en cause ne sont pas des “Tu ne dois pas... ”, ce sont des
définitions. Comme le dit Wittgenstein, vous pouvez bien entendu changer les
règles du jeu, mais alors vous changez de jeu. Ce qui n’est pas possible, c’est de
vouloir jouer au tennis tout en protestant parce que dans ce jeu, on n’a pas
le droit de marquer des buts. Il faut donc demander à ces pensées superficielles
de définir les nouvelles règles du jeu, donc de définir un jeu qui sera
nouveau pour tout le monde et qui devra donc convenir à tout le monde — que
veut-on créer ? Et c’est à ce moment que l’idée se révèle
inconsistante : on veut le tennis, celui que nous connaissons, mais on
veut y marquer des buts, on veut la vie de famille, mais sans l’institution, on
veut la politique et la dignité du citoyen, mais sans les devoirs du citoyen,
sans les nécessités de la cité… (…) » Nous sommes certainement ici devant
un point capital pour une pensée de l’autonomie, et c’est
pourquoi j’ai terminé le Complément du sujet par une réflexion sur
l’humanité des règles. Il est clair que c’est nous qui posons ou du moins
reproduisons ces définitions fondamentales dont naissent la vie de famille,
le calendrier des travaux et les jours, les idées du droit et du juste...
Elles dépendent de nous, en ce sens qu’il nous est possible de les reprendre
telles que nous les avons reçues ou bien de les
modifier. Ou encore de les reprendre en leur donnant des applications nouvelles
et inattendues. Mais, en réalité, notre pouvoir de définition n’est pas
infini. Vous pouvons certes annoncer que nous voulons
inventer une nouvelle règle du jeu, mais le sens que prendra notre acte
législatif n’est certainement pas celui que nous annonçons et que nous
pouvons contrôler, c’est un sens social qui lui
viendra de ses conséquences multiples dans nos vies et celles de nos
descendants en raison de l’interdépendance de toutes les parties du social. » La leçon commune au philosophe et au sociologue, ici, c’est qu’il faut faire preuve d’une certaine modestie : on ne peut renouveler d’un seul coup l’ensemble des institutions. Si elles n’étaient que des tabous ou des interdits, ce serait concevable. En réalité certaines d’entre elles sont des définitions, et c’est pourquoi, si on enlève ces définitions, ce qui se produit n’est pas la fête, ce n’est pas la transgression fondatrice, mais c’est le chaos conceptuel. Pas le chaos moral, pas la guerre et la violence, comme le voudraient beaucoup de philosophes politiques qui restent sur ce point trop marqués par l’individualisme sociologique, mais la paralysie, l’incompréhension, la stupeur. La tour de Babel, puisque plus personne ne se comprend, plutôt que la guerre civile, car une guerre civile suppose un haut degré de connivence intellectuelle entre les camps qui s’affrontent. » |

BOLZANO
Introduction à la Théorie des
grandeurs
(1830-1833)
Wissenschaftslehre
(1837)
[zBolzano]
Les textes
de Bolzano
[onze pages],
extraits de la Wissenschaftslehre (Bolzano
1837) et de l’Introduction à la Grössenlehre
(Bolzano 1833, composée
entre 1830 et 1833, revue dans les années 1840, mais publiée seulement en 1976)
contiennent l’essentiel de ses découvertes logiques
— la
notion de proposition et de représentation en soi ;
— l’idée
de la variation (substitution de représentations à d’autres
représentations dans une proposition) ;
— les
concepts de degré de validité et d’analyticité ;
— les
définitions des relations logiques les plus importantes entre les propositions
(compatibilité, déductibilité, équivalence, incompatibilité).
A la base
de la logique de Bolzano se trouvent les propositions en soi (Sätze an sich). Ce sont des entités de
nature intensionnelle [par opposition à extensionnelles],
caractérisées par deux propriétés essentielles : elles n’appartiennent pas
au monde réel (elles ne sont pas localisables dans le temps ou dans l’espace)
et elles sont soumises à la bivalence (elles sont vraies ou fausses). D’où la
différence aussi bien par rapport aux jugements (actes psychiques qui sont des
événements réels) que par rapport aux énoncés (suites de signes, également
réelles). Les propositions en soi sont logiquement antérieures et aux jugements
dont elles forment la matière ou contenu, et aux
énoncés dont elles constituent le sens.
Les
représentations en soi (Vorstelluntgen an sich) qui
correspondent à ce qu’on nomme traditionnellement idées ou concepts
(mais qui englobent également des intuitions), sont dérivées des propositions
en soi : elles sont définies comme parties des propositions qui ne sont
pas à leur tour des propositions entières.
Le rapport
entre les propositions et les représentations (en soi) est donc inverse :
au lieu d’être une combinaison d’idées, une proposition est une entité
primitive dont on obtient les constituants par l’analyse.
Le concept
clef de la méthode de Bolzano en logique est celui de variation. Par
variation, Bolzano
entend la substitution de certaines représentations à d’autres représentations,
qui sont « considérées comme variables » dans une proposition donnée
(sous condition de respecter les catégories sémantiques au cours de la
substitution). Cette manière de parler ne doit pas être prise à la lettre
puisqu’on ne peut rien varier dans une proposition en soi. Elle revient en fait
à considérer une classe de propositions semblables à la proposition donnée,
sauf que celles-ci contiennent d’autres représentations là où la
proposition donnée contient les représentations sur lesquelles on a opéré des
« substitutions ». Par la méthode de variation, une proposition
engendre donc une classe de propositions que Bolzano représente parfois par une
forme propositionnelle. Nous appellerons ici les propositions obtenues par la méthode
de variation des variantes de la proposition donnée. Les variantes sont
relatives au choix des représentations considérées comme variables dans une
proposition.
La méthode
de variation permet de définir les concepts logiques les plus importants,
compte tenu de la vérité ou de la fausseté des propositions obtenues. C’est
d’abord le concept de degré de validité d’une proposition, défini comme
le rapport du nombre de variantes vraies au nombre de toutes les variantes de
la proposition initiale. Le degré de validité est un nombre réel de
l’intervalle fermé [0, 1]. S’il est égal à 1, toutes les variantes d’une
proposition sont vraies et la proposition elle-même est universellement
valide (relativement aux représentations considérées comme
variables) ; si le degré est nul, la proposition est universellement
contravalide ; s’il est strictement compris entre 0 et 1, la
proposition a une probabilité déterminée par ce nombre.
L’analyticité
correspond à la deuxième étape, intermédiaire, de la construction bolzanienne :
une proposition est analytique si elle contient au moins une représentation
qui, considérée comme variable, donne lieu aux variantes qui ont toutes la même
valeur de vérité. Autrement dit, une proposition analytique contient au moins
une représentation « variable » telle que les propositions obtenues
par la méthode de variation sont ou bien toutes vraies ou bien toutes fausses.
Plus
importante est la troisième étape de cette construction par laquelle on accède
au niveau logique proprement dit et qui aboutit à la notion d’analyticité
logique et aux relations logiques entre les propositions. Une proposition est
logico-analytique si toutes ses variantes ont la même valeur de vérité
lorsque toutes les représentations non logiques qui y figurent sont
considérées comme variables. Toutefois, Bolzano observe que « le domaine des concepts
qui appartiennent à la logique n’est pas délimité de manière si nette que
jamais là-dessus aucune controverse ne puisse s’élever ». Dans les remarques
au § 148, il ajoute que les propositions qui peuvent se réduire aux
(logico-) analytiques par substitution de la définition au défini sont
également (logico-) analytiques.
Bolzano
peut appliquer maintenant sa méthode pour décrire les relations logiques. La compatibilité
(Verträglichkeit) entre deux
classes de propositions A et M (relativement
aux « représentations variables » choisies) sera définie par
l’existence d’au moins un système (Inbegriff) de
représentations qui, substitué aux représentations « variables »
correspondantes dans A et dans M, rend
toutes les propositions de A et de M vraies. De
manière semblable, Bolzano obtient la relation logique la plus
importante, à savoir la déductibilité (Ableitbarkeit) entre deux
classes de propositions, qui correspond à la conséquence logique : la classe M est
déductible de la classe A si chaque système de représentations qui,
substitué aux variables dans les propositions de la classe A, les
rend toutes vraies, rend également vraies toutes les propositions de la
classe M. Il est à noter que la déductibilité
bolzanienne
est un cas particulier de la compatibilité ; cette clause permet d’une
part d’affaiblir la déductibilité en relation de probabilité d’une
proposition M relativement à une classe d’hypothèses A,
d’autre part de considérer la déductibilité comme cas limite de la probabilité.
J. SEBESTIK
*
* *
Propositions et représentations en
soi
(Bolzano, Introduction à la Théorie des grandeurs, 1833, II, §2)
1) On comprendra ce que j’entends par proposition dès que je remarque que ce n’est pas pour moi ce que les grammairiens appellent une proposition, à savoir l’expression verbale, mais uniquement le sens de cette expression, lequel, nécessairement et toujours, ne peut être que vrai ou faux : une proposition en soi ou une proposition objective. J’accorde bien l’existence à la conception d’une proposition dans l’esprit d’un être pensant, je l’accorde bien aux propositions pensées et aux jugements qu’on porte, à savoir l’existence dans l’esprit de celui qui pense ces propositions et qui porte ces jugements. Mais les pures propositions en soi, ou les propositions objectives, je les compte parmi une espèce de choses qui ne sont absolument en rien des existants, et qui ne pourront non plus jamais le devenir. Que nous pensions à une proposition, que nous jugions qu’une chose soit ainsi ou autrement, cela est quelque chose de réel, qui est apparu en un temps déterminé et qui cessera aussi en un temps déterminé ; les signes écrits, par lesquels nous couchons quelque part de telles propositions, sont de même quelque chose qui appartient à la réalité ; mais les propositions mêmes n’appartiennent à aucun temps et à aucun lieu.
2) Si, comme je l’espère, on peut comprendre d’après ce qui vient d’être dit, ce que j’entends par propositions en soi ou proposition objective, on comprendra également ce que j’appelle une représentation en soi ou représentation objective. Dans chaque proposition peuvent, en effet, être distinguées plusieurs parties et si celles-ci ne sont pas à leur tour des propositions entières, je les appelle représentations ou (en tenant compte d’une différence qui doit être expliquée par la suite), parfois aussi concepts. Ainsi, la proposition : Dieu a l’omniscience, se compose de parties : Dieu, a et omniscience ; je les appelle par conséquent représentations. De même qu’une proposition en soi n’a pas de réalité (Wirklichkeit), de même ses parties, i.e. les représentations ou concepts en soi n’ont pas de réalité. Une représentation en soi doit par conséquent être nettement distinguée de sa conception dans l’esprit d’un être pensant (d’une représentation subjective, pensée). Car à cette dernière appartient évidemment la réalité. Si je suis en train de penser maintenant à une montagne d’or, la représentation: montagne d’or, représentation subjective, existant dans mon esprit, a bien entendu la réalité, à savoir pendant le temps qu’elle existe dans mon esprit. En revanche, la représentation objective qui est à la base de cette représentation subjective (celle-ci n’est qu’une conception de celle-là), la pure représentation en soi, n’est et ne saurait absolument pas être quelque chose d’existant. Non certes, parce que — comme c’est le cas seulement dans cet exemple — il n’y a pas de montagne d’or, mais parce que si les représentations en soi étaient quelque chose de réel, a leur tour les propositions en soi, dans lesquelles ces représentations figurent comme parties, devraient être quelque chose d’existant.
3) Pour saisir la différence qui vient d’être décrite entre les propositions et les représentations encore plus complètement, il sera utile de mentionner une propriété par laquelle les représentations et les propositions se distinguent de manière caractéristique. Toute proposition, toute proposition complète est toujours l’un des deux seulement : ou bien vraie ou bien fausse ; en revanche, ni la vérité ni la fausseté n’appartient aux représentations seules. Par exemple, la proposition : toute ligne est divisible, doit être qualifiée de vraie; la proposition : tout point est divisible, de fausse. S’il semble bien que certaines représentations, par exemple « montagne d’or », « rectangle rond », peuvent être appelées fausses, c’est seulement dans la mesure où nous supposons que quelqu’un affirme les propositions : il y a une montagne d’or, il peut y avoir des rectangles ronds, et semblables. C’est de cette manière seulement que nous le comprenons lorsque nous parlons de concepts faux et de représentations fausses.

Manneville,
propriété des Turgot depuis 1613
|
Le péché
d’hypostasie consiste à prétendre que l’idée d’économie est l’idée d’un objet
réel. L’idée d’économie n’est qu’une idée dans la pensée bourgeoise et cette
idée n’est pas l’idée d’un objet réel, contrairement à ce que tout le monde croit… (tout le monde car, aujourd’hui, je ne connais que
deux auteurs qui le sachent, strictement parlant, le surintendant Fourquet et
moi, ne vous en déplaise). L’idée d’économie satisfait la précondition (0) de
Hacking : « (0) : “Dans l’état actuel des choses, X
est tenu pour acquis ; X apparaît comme inévitable.” » A tel point que même les
Fidjiens vivaient, paraît-il, dans une économie de chasse et de cueillette.
La condition (0) est parfaitement remplie : il existe des sociétés sans
argent, il n’existe pas de sociétés sans économie (cf ci-dessous le cas de Marx),
c’est inévitable, il ne saurait en être autrement, c’est indiscutable.
C’est toujours ce qui me fut rétorqué, le mot inévitable du virtualisme est
employé : « c’est indiscutable », il ne saurait en être
autrement. Fureur du conformisme. Convention
is general conforming. Meuh ! Bêêê !
Hi ! Han ! L’idée d’économie fait donc parfaitement « état d’une
précondition pour qu’il existe une thèse
de constructionnisme social à propos de » l’idée d’économie. C’est un cas idéal pour soutenir une thèse
constructionniste. Or, c’est très amusant, la racaille déconstructiviste et
constructionniste (blancs bonnets et bonnets blancs) a soigneusement évité ce
cas parfait. Seul Hacking, à ma connaissance, remarque sa possibilité. Enfin Hacking termine ce
chapitre ainsi : « Dans ce qui suit, j’insisterai
énormément sur la distinction
difficile entre
l’objet et l’idée. Le point de départ (0) ne vaut pas pour
des objets (le déficit ou l’économie). Il est clair que notre économie
et notre déficit actuels ne sont pas inévitables. Ils sont le
résultat contingent d’événements historiques. Le point de départ
(0) vaut par contre pour les idées de l’économie et du déficit
; ces idées, avec la plupart de leurs
connotations, semblent inévitables. »
Effectivement la distinction entre
l’idée et l’objet est difficile puisque Hacking n’a pas remarqué que l’idée
d’économie n’est pas l’idée d’un objet réel puisqu’il écrit :
« Le point de départ (0) ne vaut pas pour des objets (le déficit ou l’économie). Il est clair que notre économie et notre déficit
actuels ne sont pas inévitables. » Il
est comme de Dr Latouche. Hacking serait bien capable de nous parler de
l’économie de chasse et de cueillette des fidjiens. Mais rendons lui cette
justice : il déclare ne pas vouloir employer le terme construction. Ma thèse sera donc, à propos de la construction : Il
y a construction quand et seulement quand l’idée d’un objet n’est pas l’idée
d’un objet réel. Hacking dit lui-même qu’il ne peut pas y avoir construction
sociale d’un objet (réel) mais seulement construction sociale d’une idée. Voici
un exemple d’un tel objet : quel est le
nom de l’objet qui provoque une coupure dans l’ensemble des nombres
rationnels telle que cet ensemble est coupé en deux sous-ensembles, a
et b, tels que tout élément de a est strictement
inférieur à tout élément de b et que tout élément de b est strictement
supérieur à tout élément de a ; le strictement impliquant
que l’ensemble a n’a pas de plus grand élément et que l’ensemble b
n’a pas de plus petit élément ? Cette dernière propriété, dans les cas
où elle est démontrable, signifie que la coupure n’est pas produite par un
nombre rationnel car l’objet qui produit la coupure n’appartient ni à a
ni à b. Le mystérieux objet qui résulte de la construction de la
coupure est un nombre irrationnel. La construction est due à Dedekind :
« Chaque fois que nous sommes en présence d’une coupure (a,b)
non produite par un nombre rationnel nous créons un nombre nouveau,
irrationnel x, que nous considérons comme parfaitement déterminé par cette
coupure (a,b) ; nous dirons que le nombre x correspond à
cette coupure ou qu’il engendre cette coupure. » Ça nous change un
peu du nombre « trois » que je choisis toujours comme exemple en
mémoire de J-S Mill dont les recherches sur les nonnettes s’arrêtèrent là, en
évitant soigneusement le cas du zéro et du « un » qui furent
résolus par Frege. Toutes les choses sont des objets mais tous les objets ne
sont pas des choses. La
construction de l’économie ne concerne pas seulement la construction de
l’idée d’économie mais aussi bien (de façon inséparable) la construction de
l’objet « économie ». L’objet « économie » n’est pas un
objet réel mais seulement l’objet d’une croyance. Plus
précisément : ce qui est socialement construit ici, ce n’est pas
l’économie, qui n’existe pas, mais la croyance en l’existence de l’économie. Ce qui échappe à Hacking, c’est que dans le cas de
l’économie ce n’est pas (page 37, Degrés d’engagement
constructionnistes) (1) que X soit non inévitable,
(2) que X soit une mauvaise chose, (3) que le monde
serait bien meilleur sans X ; c’est que X
n’existe pas. Seule la croyance en l’existence de X existe et
elle est très datée comme le souligne parfaitement Hacking étant donné que
c’est lui qui m’a donné la date de son déferlement ; de même que le
surintendant Fourquet m’a donné le nom de son inventeur et la date précise de
son invention ainsi que les raisons de cette invention. La construction de
l’objet ne se distingue pas de la construction historique de la croyance
puisque l’objet n’existe pas. L’objet consiste dans la croyance et seulement
dans la croyance. L’objet consiste dans le péché d’hypostasie et l’objet
d’étude n’est pas l’objet X mais cet objet réel Y
qu’est la croyance en X, cet objet réel qu’est le péché
d’hypostasie. Le signor Latouche croit qu’il suffit de croire (« Pour que la vie économique existe, il faut et il suffit
qu’elle soit pensée. » MIRACLE !) à l’existence
de l’économie pour que l’économie existe. Dans ce cas, c’est seulement la croyance en l’existence de l’économie qui est
l’objet réel et non l’économie. La croyance est le seul objet réel dans cette
affaire ; c’est elle et elle seule qui a des conséquences dans le monde
et non pas l’objet prétendument réel de la croyance. Dieu ne fait
rien. La religion
fait tout. C’est l’opium du peuple. L’opium du peuple est un objet réel. Il n’y a pas construction
de l’économie mais construction de la croyance en l’existence de l’économie.
Ces conséquences ne sont pas économiques, évidemment mais de conformation. La
principale conséquence de la croyance est de produire et entretenir la
sottise, de justifier et conforter l’impuissance et la passion du conformisme.
Vous avez
la main invisible au cul et vous aimez ça. Pendant ce temps, les choses vont leur
train sans rien demander à personne. C’est la croyance et non pas son objet
prétendument réel qui satisfait au critère de réalité de Lévi-Strauss. Et,
enfin, c’est évidemment une affaire collective : on ne croit pas tout
seul que l’économie existe. D’aucuns croient à la vie économique comme
d’autres croient à la vie éternelle. L’économie est un objet
construit qui a la particularité de ne pas exister hors de la croyance en son
existence. La construction de cet objet ne se distingue donc pas de la
construction de sa croyance. Plutôt, c’est une idée qui est construite et
l’objet de cette idée est pris pour un objet réel. Je cite désormais la fin du
chapitre Degrés d’engagement : « Rappelons-nous
l’économie. Comment nous serait-il possible de penser au monde industriel
sans penser à l’économie ? C’est là où notre constructionniste social
ironique, voire dénonciateur, pourrait entrer en scène. L’ironiste montre
comment l’idée
d’économie s’est établie si fermement ; cela pouvait ne pas être,
mais maintenant elle fait si intimement partie de notre manière de penser que
nous ne pouvons y échapper. Le dénonciateur exhibe les idéologies qui
sous-tendent l’idée
d’économie et révèle les fonctions extrathéoriques et les intérêts
qu’elle sert. Jadis, il y avait des militants qui seraient passés à la rébellion et même à la
révolution sur cette question de l’économie. Leur tâche devient de
plus en plus difficile avec l’hégémonie du système mondial. Ce qui fut à un
certain moment considéré comme contingent est envisagé à présent comme
constitutif de l’esprit humain. Il suffit d’un peu de détermination pour
devenir un constructionniste rebelle sur la question du déficit. Mais
peut-être que la seule manière de devenir constructionniste quant à
l’économie est de passer directement de l’ironie à la révolution. » Ce n’est pas seulement le
monde industriel qui est pensé sans qu’il soit possible, prétendument, de ne
pas se référer à l’objet économie mais tous les mondes, notamment
celui des Fidjiens qui se retrouvent affublés, eux aussi, d’une économie de
chasse et de cueillette. L’idée d’économie s’est établie fermement,
certes, mais ce n’est pas seulement l’idée mais l’objet de l’idée puisqu’il
n’est pas un objet réel. Hors de l’idée d’économie, il n’est rien, nulle
chose. « L’économie est seulement une idée dans la pensée
bourgeoise. » Quand des militants passèrent à la révolution sur la
question de l’économie, à la suite de leur mentors Marx et Lénine, ce fut
pour traiter pratiquement d’un objet inexistant. C’est ça le stalinisme avec
les résultats que l’on sait. Aujourd’hui, il n’est pas besoin de révolution
mais seulement de logique pour montrer que l’idée d’économie n’est pas l’idée
d’un objet réel. Le dictionnaire et l’apport de Frege et Bolzano
suffisent. Ce n’est pas le rôle de la philosophie de mettre fin au régime
bétailler qui est celui de l’humanité dans le système des besoins [ des besoins réciproques dit Turgot ].
Les musulmans fanatiques se sont attelés à ce travail d’une brutale manière
qui est la réponse à deux siècles de brutalité. The
chickens comme home to roost. Le monde dit libre, dont la
liberté se résume à la liberté de chier partout et sur quiconque, est
l’héritier de Staline, c’est un stalinisme sans Staline mais avec beaucoup de
staliniens, c’est à dire d’adorateurs de « cette splendide idole »
qu’est le prétendu objet réel économie. Ce
n’est plus Big Brother, c’est Big Oil. C’est
pourquoi les altermondialistes ne sont que des idem-mondialistes, c’est à
dire des staliniens comme les autres. Il ne faudrait pas croire, non plus,
que l’économisme consiste à donner trop d’importance au prétendu objet réel économie.
Il consiste à donner trop d’importance aux économistes et à leurs
prétentions. S’il existait un objet réel qui serait l’économie, on ne saurait
lui donner trop d’importance, on ne saurait donner trop d’importance à ce qui
est réel. Les idem-mondialistes sont des économistes comme les autres,
peut-être pire encore. Enfin, il est encore un cas
parfait de construction sociale, c’est celui de l’attitude « avoir des besoins ».
Il est inévitable que les sauvages aient eu des besoins, il est impensable
qu’ils n’en n’aient pas eu, ces sauvages qui vivent dans une économie de
chasse et de cueillette. Même Polanyi s’y laisse prendre.
Or « avoir des besoins » est une attitude qui présuppose
l’existence d’un système des besoins, ce qui n’est pas le cas chez
les sauvages. Les sauvages jardinent et pêchent collectivement. Chez
eux se nourrir est une affaire collective qui inclut d’ailleurs « la
nature », ce qu’elle n’est plus chez nous. La grosse affaire dans cette affaire
collective, ce qui passionne les sauvages, c’est la magie. Il n’y avait pas
de système des besoins avant 1665, date à laquelle est apparue la locution.
« Avoir des besoins » était une attitude inconnue au moyen-âge et
dans l’Antiquité. On peut y être « dans le besoin », « avoir
besoin de… » mais on ne peut y « avoir des besoins ».
« Avoir des besoins » est un objet très récent : trois
siècles. C’est à quoi est réduit le bétail contemporain. Il s’épuise dans la
« satisfaction de besoins » autre objet très récent. La satisfaction
de besoins coïncide avec la désertion de l’esprit. C’est l’homme réduit au
« triste sac » et ses deux orifices. |
|
Il y a peu, j’écrivais que je fus immédiatement
choqué, lors de ma première lecture du Capital, de la prétention de Marx à
vouloir faire d’une partie de la société la raison de la totalité. Ce faisant,
j’étais cependant étonné de ce souvenir puisqu’il me semblait également que Marx
ne traite pas de cette question dans le Capital, du moins pas
immédiatement. Or en recherchant les
nombreuses invectives de Marx à l’encontre de Say, je tombe sur
ceci : « “Les économistes ont une singulière manière de procéder.
Il n’y a pour eux que deux sortes d’institutions, celles de l’art et celles
de la nature. Les institutions de la féodalité sont des institutions
artificielles, celles de la bourgeoisie sont des institutions naturelles.”
(…) Le plus drôle est Bastiat
[ c’est à dire encore plus bête que Say.
Deux sites bastianistes : l’individualisme dans toute sa splendeur.
L’individu est un serpent qui a pour devise « Nul ne m’emmerde impunément » (NEMo me
impune Lacesset). Le monde comme nœud de vipères. Que voilà de
fières vipères. A quand the
adder pride. « Le libéralisme est une cybernétique de l’Action
Humaine », mais le monde n’est pas un mécanisme et le libéralisme est seulement
une doctrine. La cybernétique n’est qu’une branche de la mécanique. « Cybernethics
is a dynamic point of view on human life »,
soit ! mais seulement un point de vue… d’allumé. Un point de vue sur le
monde n’est pas un monde. Cela dit, d’après le Dr Petit, Iter ne
s’allumera jamais ], qui se figure que les Grecs et les Romains n’ont vécu que de rapine
[ Rébus : dard/1, nœud, vît, queue, 2 rats, pine ]. Mais
quand on vit de rapine pendant plusieurs siècles, il faut pourtant qu’il y
ait toujours quelque chose à prendre ou que l’objet des rapines continuelles
se renouvelle constamment. Il faut donc croire que les Grecs et les Romains
avaient leur genre de
production à eux, conséquemment une économie, qui formait la base matérielle de leur
société, tout comme l’économie bourgeoise forme la base de la
nôtre. » (Éditions socialiniennes. Livre premier, tome I,
page 92, note) Page 92 ! (quarante et unième page du
texte proprement dit). Ça commençait bien ! Il y a donc, en toute
société, « un genre de production », conséquemment « une
économie » composée de principales bêtes féroces de la ménagerie :
forces productives, rapports de production enfermées dans la cage du mode de
production, et cette économie forme la base matérielle de toute société.
Voilà la couleuvre que Marx essayait de me faire avaler en 1962. La ménagerie
du crétin Say comprenait, elle, La Production, La Distribution,
La Consommation. L’ennui, c’est que s’il y a beaucoup de choses
produites, La Production ne produit rien ; s’il y a beaucoup de
choses distribuées, La Distribution ne distribue rien ; s’il y a
beaucoup de choses consommées, La Consommation ne consomme rien. C’est
déjà du virtualisme. C’est l’opération du Saint-Esprit, et, pour les mécréants,
c’est la main invisible. Il ne s’agit pas, ici, du sens tel qu’on le trouve
dans le Webster de 1913, sens
qui serait admis par Fourquet : “2. Orderly
arrangement and management of the internal affairs of a state or of any
establishment kept up by production and consumption; esp., such management as
directly concerns wealth; as, political economy” ; mais bien du
sens inventé par le crétin Say vers 1820. D’ailleurs, je vais encore reprendre ce début du Capital tant j’y vois de choses intéressantes, qui d’ailleurs plaident contre Marx. Il avait tout sous la main dès le début. |
Il y a système des besoins quand in abstracto :
1) Tous les producteurs font face aux consommateurs.
2) Tous les producteurs ne produisent pas des chaussures alors que tous les consommateurs en portent.
3) Tous les producteurs ne produisent pas du bifteck alors que tous les consommateurs en mangent.
4) Etc.
5) Cependant, tous les producteurs sont les mêmes, exactement, que tous les consommateurs.
6) Donc le prétendu producteur n’est qu’en apparence un producteur mais en fait un consommateur qui se prostitue.
7) Le producteur de chaussures ne produit qu’en apparence des chaussures mais en réalité des chaussures, du bifteck etc., chaussures, bifteck etc. qu’il a déjà achetés en pensée avec l’argent de sa passe. A quoi pense la pute pendant la passe ? A son vison blanc.
9) Le but affiché de la « science économique » est que tous les consommateurs trouvent chaussure à leur pied et bifteck à leur faim dans le plus parfait équilibre. A chacun sa chacune, à chacun ses chaussures et les vaches seront bien gardées. En fait, calculer un prix de revient est très simple, il suffit, depuis deux cents ans seulement, de savoir additionner. Ce qui est difficile pour les maîtres qui achètent l’obéissance des prostitués, c’est de savoir 1) s’ils vendront la merde produite par les prostitués pour les prostitués, b) s’ils vendront au dessus du prix de revient, c) s’ils vendront suffisamment au dessus du prix de revient. C’est la seule chose qui les intéresse. Toute la « science économique » est là.
Le problème est donc que les chaussures aillent depuis un certain endroit aux pieds auxquels elles sont destinées, ce qui est manifestement un problème de communication.
Concrètement, cette structure in abstracto est réalisée dans des institutions concrètes qui, toutes, doivent satisfaire le critère de réalité de Lévy-Strauss. Mais… cette structure n’est pas réalisée comme le serait un plan, un modèle, une maquette etc., elle est, au contraire un résultat qui n’est possible que du fait des institutions et de la logique des institutions. La logique des institutions repose dans les institutions et non dans la structure qui n’est qu’une abstraction a posteriori. La structure a posteriori n’a aucune efficacité. Cette structure n’est en fait qu’un idealtype !
C’est beau la civilisation. Bétail, tant de veaux ! tant !
La religion n’a pas été critiquée puisqu’elle n’a pas été comprise. Éradiquer n’est pas critiquer (Hegel disait qu’on ne peut critiquer réellement un système qu’en partant des présupposés de ce système). Enfin, l’éradication de la religion a splendidement échoué. Le berceau du monothéisme est aussi le conservatoire de la foi, c’est à dire le conservatoire de la confiance (Le Maussade ne peut infiltrer le Hezbollah). Au contraire, l’enculisme est la généralisation de la défiance. Il repose sur la défiance.
|
[1] Mais en quoi
la découverte de l’inexistence de l’économie est-elle si importante? [2] Si tous
les faits économiques ne forment pas "l’économie" mais autre chose
— qui n’est pas un mensonge, une idéologie — alors quoi ? [3] D’autre part,
la portée de cette découverte me semble devoir être relativisée. Car quand
bien même l’économie n’existerait pas, cela n’empêche pas les faits économiques,
eux, d’exister durement. Comment Voyer baptise-t-il une délocalisation, par
exemple ? Est-ce que la baisse du pouvoir d’achat constitue un fait
économique ? La marchandise est-elle oui ou non du temps de travail
social moyen cristallisé dans un objet, et dont la valeur se sert de la
valeur d’usage pour être valorisée ? [4] Autre
question : quel est le sens d’une science de l’humanité, qui
reste à fonder si j’ai bien lu Voyer ? Miss
Kalhydre sur le Debordel le 7 février 2005 [J’avais déjà répondu par avance ici aux
points 1 et 2] 1. La découverte de l’inexistence de l’économie est une découverte négative. Elle ne dit pas ce qui est, elle dit ce qui n’est pas. C’est là son seul mérite et c’est déjà beaucoup dans un monde virtualiste qui nous accable d’inexistences, dans cette merveilleuse civilisation qui chie partout. Rien n’a jamais empêché personne de le faire à ma place, mais rien est le pire ennemi qui soit. Il est insaisissable [Bolzano dit que la représentation « rien » est la plus étonnante qui soit car elle n’a aucun objet : la représentation rien ne représente rien (2013)]. L’ambition de cette découverte est justement d’aider à la découverte de ce qui a lieu, parce que manifestement quelque chose a lieu (quoique Berkeley soutînt que non et, ce qui mettait Leibniz en rage, il avait réponse à tout, on ne pouvait jamais le prendre en défaut, et Leibniz n’était pas n’importe qui). Si ce n’est pas l’économie c’est donc autre chose, effectivement. Là est la question. Rien ne vous empêche de vous y atteler. J’ai oublié la phrase célèbre de Marx qui dit en substance que les idées sur le monde ne sauraient aller au-delà du monde mais seulement au-delà des idées sur le monde. L’ambition de cette découverte est de susciter et de permettre de nouvelles idées. Elle n’a rien des rodomontades à la Debord qui plaisent tant aux virtualistes. 2. Erreur : tous les faits économiques forment bien l’économie. Selon des dictionnaires : l’économie est l’ensemble des faits… bla bla bla, en fait l’ensemble des faits dits économiques. Simplement, de même que l’ensemble des arbres d’une forêt n’est pas une partie de la forêt (Descombes, Les Individus collectifs, 1992. Frege : ne pas confondre l’ensemble des arbres d’une forêt et la forêt), l’ensemble des faits économiques n’est pas une partie de la société. Un ensemble de ce que vous voudrez ne peut être partie que d’un autre ensemble. Point final. De même, la population française est soit le nombre, soit l’ensemble des Français, le nombre étant le cardinal de l’ensemble. Ainsi, la population française n’est pas une partie de la France, ce que je disais déjà dans ma Critique de la raison impure commencée en septembre 2000 et ce que Marx tente de dire dans Grundrisse. Voilà une proposition plus forte, parce que beaucoup plus précise, que : « L’économie n’existe pas ». La moindre branche du moindre arbre, à titre de partie de cet arbre, lui-même partie de la forêt, cette branche donc, est une partie de la forêt. L’ensemble des arbres de la forêt n’est pas une partie de la forêt. Le moindre franchouillard, le moindre village, sont des parties de la France, mais la population de la France n’est pas une partie de la France. Étonnant, non ? Vous n’aviez jamais pensé à ça ? Moi non plus. Il est formidable ce Descombes. Voilà de l’idéologie délirante, diraient les petits cons et avortons situ-gauchistes qui ont la science infuse (comme les petits cons maoïstes de l’ENS en 1968). C’est seulement de la logique. Mais il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin. Voici maintenant la différence entre une nation et une forêt : les hommes d’une nation peuvent vivre ensemble, les arbres d’une forêt ne le peuvent pas (Descombes, encore, à moins que ce ne soit Lewis ou Barwise). L’ensemble des Français n’est pas une partie de la France, mais les Français vivent ensemble, ce que ne peuvent faire les arbres d’une forêt. En 1963, je fus choqué que Marx, malgré ses principes hégéliens affichés (le tout est le vrai, seul le tout a lieu), prétendît qu’une partie de la société pouvait être le fondement de la société. Cela me conduisit, treize ans plus tard, à la proposition radicale que l’économie n’était aucune partie de la société (je ne formulais pas cela en ces termes à l’époque, évidemment). Je fonde ma preuve de l’inexistence de l’économie (sa non existence à titre de partie de la société, partie de la vie en société) sur Frege et Descombes. Si vous voulez contester ma preuve il vous faudra donc contester Frege et Descombes. Cela répond aussi à la question : que doit être une science de l’humanité, que doit être une science de ce qui a lieu ? Une science de l’humanité doit être une science des parties (honteuses), une science de la société dit Mauss. 3. Les faits sont des état des choses. Les faits sont un résultat. Un fait est ce qui a eu lieu, ce qui est le cas, ce qui est arrivé. Tout fait est un fait accompli. « Fait accompli » est un pléonasme. Les juristes disent « voie de fait » et non pas « voie de fait accompli ». Selon Frege, un fait est une pensée vraie. Pour ces deux raisons, les faits ne font rien. A fortiori donc l’ensemble des faits. Exemple de fait : « La Lune est tombée sur la Terre ». Fort heureusement, le sens de cette phrase (une pensée selon Frege) est fausse, la phrase dénote le faux. Ouf ! Mais si c’était le cas, ce n’est pas le fait qui serait dur, mais la Lune et la gravitation. C’est la Lune la fautive. Le fait ne fait rien. C’est un fait que Napoléon a gagné la bataille d’Austerlitz. Mais ce n’est pas le fait qui a gagné, c’est Napoléon et sa vaillante armée fanatisée. Autre exemple de fait : « La Lune s’éloigne de la terre de quelques centimètres par an ». Ce fait est un résultat. Ce qui est important c’est de savoir pourquoi la Lune s’éloigne de la Terre. Pour le savoir, lisez le Dr Petit, il sait tout. De même, ce qui importe pour les faits classés « économiques » par les économistes, c’est de savoir ce qui les provoque et les permet et qui n’est ni l’économie, ni la gravitation. Ce qui est dur, ce n’est pas les faits économiques mais ce qui les provoque et les permet. Ce qui les provoque et les permet n’est ni économique, ni gravitationnel et demeure strictement inconnu à ce jour. Il faut appeler une délocalisation une délocalisation et ce qui est cause de dureté dans ce cas est parfaitement connu et empalable. Dire qu’elle est un fait économique n’ajoute absolument rien au fait, ni à sa connaissance. Autant ajouter Inch Allah. Je l’ai déjà dit : vous pouvez enlever l’adjectif économique partout où il paraît, le sens de la phrase ne change pas ou bien vous pouvez, grâce à une modification mineure de la phrase, éliminer l’adjectif économique, partout. Écrire l’adjectif économique est seulement un acte de prosélytisme, souvent inconscient, simple signe de soumission, la trace du collier de la fable Le Chien et le loup. Viens dans ma chapelle que je t’encule. Regarde mon beau virtualisme tout neuf. D’ailleurs, une délocalisation n’est pas un fait avant qu’elle ne soit accomplie, mais un acte qui requiert un motif (encore Descombes, c’est là la différence avec la Lune qui n’aurait, si elle tombait sur la Terre, aucun motif de le faire). Elle devient un fait quand elle est accomplie. Ensuite de donner au fait ou à l’acte le sobriquet « économique » n’ajoute rien, ni aux faits, ni aux actes. Comme le dit très bien Fourquet : c’est un classement, c’est tout. Comme le dit encore Fourquet (le surintendant Fourquet), pour s’en scandaliser, les faits économiques sont dits économiques parce que la prétendue science économique prétend les étudier. La science économique ne fait que peindre du gris sur des faits gris dirait Hegel. De même le classement des animaux n’ajoute rien aux animaux qui ne deviennent pas pour autant « zoologiques » et le classement des cartes à jouer ne fait ni froid ni chaud aux cartes qui ne deviennent pas pour autant « taxinomiques ». Tandis que la qualification de certains faits de « météorologiques » indique que ces faits ont lieu dans le ciel, la qualification d’ « économiques » n’indique pas que des faits ont lieu « dans l’économie » comme le prétendent les virtualistes mais seulement qu’ils sont étudiés par la « science économique ». L’économie n’étant pas une partie du monde, aucun fait, fut-il qualifié d’« économique », ne peut avoir lieu dans l’économie. Les faits ont lieu dans le monde, ils sont partie du monde. La prétendue science économique ne fait, pour des raisons qui lui sont propres et dont je ne parlerai pas ici, que mettre son estampille (comme Bernard Lévy, la mouche du coche des charniers de Sarajevo) sur des faits du monde. Les faits économiques sont des faits du monde avant que d’être estampillés « faits économiques ». Si les faits avaient lieu dans l’économie, ils n’auraient plus lieu dans le monde puisque l’économie n’est pas une partie du monde. De même, quand une forêt brûle totalement, ce n’est pas l’ensemble des arbres qui brûle car un ensemble de peut pas brûler. C’est aussi simple que cela. Ajouter le sobriquet « économique » c’est faire ce que faisait Eschyle ajoutant « et il perdit une petite fiole » aux vers d’Euripide afin de jeter la confusion. Dans ce monde virtualiste, on vit il y a peu un nègre américaniste agiter une petite fiole à la tribune de l’ONU dans le but de jeter le trouble, opération parfaitement réussie (le but des américanistes est la confusion, donc quand ils ratent, ils réussissent. C’est la théorie de la perfect storm). C’est un procédé vieux comme le monde. La « science économique » est l’idéologie chérie des virtualistes qui causent dans le poste d’un ton péremptoire. La réalité est le principal adversaire des virtualistes. Le but d’une science de l’humanité est de connaître ce qui se meut en lui-même, pour parler comme Hegel, dont la profondeur est infinie (comme dans la monadologie, tous les éléments se manifestent dans chaque élément sans exception, c’est une sorte d’application interne — la totalité se supprime comme apparence en direction de l’immédiateté de l’individu — qui constitue le tout en tout concret), et qui permet les états des choses (choses sociales dans ce cas). Dans quoi ont lieu les faits ? De quoi sont les faits ? Ces questions sont encore sans réponse. Résumé : celui ou celle qui dit « fait économique » ne fait que dire « fait ». Celui ou celle qui dit « Il y a des faits économiques » ne fait que dire « Il y a des faits ». Quelle surprise ! Il y a des faits. Oui et alors ? Il n’y a de faits que sociaux. Qualifier certains d’entre eux d’« économiques » n’ajoute rien à ces faits mais retranche, cela dans un but, souvent atteint, que je ne traiterai pas ici. Comme dit si bien le surintendant Fourquet, ce n’est qu’un classement. Les individus collectifs concrets ne sont pas, comme les individus collectifs pensés, telle l’économie, des ensembles. Que sont-ils ? Là est la question. Toute suggestion sera la bienvenue. Pour ma part, je n’ai réussi qu’à dire ce qu’il ne sont pas. Je suis heureux de constater que je ne suis plus seul à le faire. * * * La valeur, l’argent, sont des institutions. Il ne sert à rien de qualifier ces institutions d’« économiques », leur connaissance demeure toujours notable quantité d’importance nulle. Autant les qualifier de petites fioles. Sainte-Hélène, petite fiole ! Cependant, cette qualification n’est pas innocente, mais je ne traiterai pas ce problème ici. Les institutions ne sont pas des ensembles de faits et jamais un ensemble de faits ne fit une institution. L’économie n’est aucune institution, l’économie est seulement une classe de faits. Une classe de faits n’est aucune partie de la société, aucune partie de la vie en société. Il n’y a pas de vie économique, mais présentement, esclavage, prostitution et domesticité réciproque des prostitués, ce que Hegel, toujours bien inspiré nomma système des besoins, ou société bourgeoise (« Bürger als bourgeois » § 190, Philosophie du droit et non pas als citoyens. Chez les bourgeois — y compris les idem-mondialistes — on ne tire la chasse d’eau que pour les gros besoins. Quelle élévation d’esprit) Pour la première fois dans l’histoire, la présente société est un système des besoins. Avant 1800, il n’y eut jamais dans le monde de système des besoins : en 1800, l’idée des besoins (pluriel, apparition dans ce sens : 1665) était une idée neuve en Europe. « Avoir des besoins » est une caractéristique de l’esclave, prostitué et domestique réciproque moderne et de lui seul. Ni le serf, ni le seigneur, ni le sauvage n’avaient de besoins ; pourtant ils mangeaient, buvaient, chiaient et pissaient comme tout le monde. Cela donne envie de bombarder. Les jeunes gens nègres et bougnoules des banlieues à qui cette société ne donna pas l’immense chance d’être un esclave prostitué domestique réciproque sont donc… libres, liberté brute, évidemment, raw freedom, liberté à l’état naissant, désordre créatif. La liberté brute est brutale, que voulez-vous. Allo, maman bobo ! Je suis persuadé qu’ils apprécient leur chance. J’ai dû lutter âprement pour être libre. J’ai dû refuser toutes les merveilleuses chances qui me furent offertes (aujourd’hui, je regrette seulement de ne pas lire le grec et l’allemand. Je trouve absolument scandaleux que l’on fasse des études pour croûter. C’est insulter la sainteté de l’esprit. Il n’est pire salaud que le si vil innocent). Eux se sont seulement donné la peine de naître nègre ou bougnoule en banlieue. Après cela, vous vous étonnez qu’ils tapent la multitude des petits cons de lycéens Jospin vagissants, nés soumis, qui vivront soumis et mourront soumis, esclaves, prostitués et domestiques réciproques [ Turgot : « besoins réciproques » ] et qui vont bientôt veauter pantalon, caleçon ou culotte. La tentative qui eut lieu dans la Russie dite soviétique ne fut rien moins qu’une tentative pour prendre en main la prétendue institution « économie ». La suite a démontré parfaitement que l’on ne peut pas prendre en main l’économie parce que l’économie n’est pas une institution. On peut prendre en main une institution, on ne peut pas prendre en main les faits d’une classe de faits qui sont, fondamentalement, sans rapport entre eux, sans rapport autre que le classement qui leur a été infligé par les virtualistes. Leurs rapports effectifs sont ailleurs, dans le reste du tout qui a été négligé. Si l’on classe des faits interdépendants (dans un but que je ne traiterai pas ici), ils demeurent interdépendants, mais ils ne sont pas interdépendants parce qu’on les classe mais parce qu’ils étaient déjà interdépendants avant le classement. Ce faisant, on perd de vue la raison de leur interdépendance. C’est le virtualisme. Les Russkofs ont appris à leurs dépens que l’on ne peut pas organiser les faits d’une classe de faits. Marx a poussé à son extrême la stupidité du crétin complet Say (ce n’est même pas lui l’inventeur du sucre de betterave pendant le blocus continental, c’est Vauquelin propriétaire du magnifique château des Giberville, 1609, rue Cateline — Catherine, scarlet empress —). Le marxiste radical Lénine a fait le reste (notez cependant qu’il s’apprêtait à faire le Chinois d’aujourd’hui (la NEP) avant que de mourir. La mort de Lénine fut certainement un malheur pour l’humanité, lui seul était capable, alors, de réparer le mal qu’il avait fait. Pas de chance, n’est-ce pas ? La réalité se venge toujours cruellement. La réalité réside dans le tout. La réalité est l’ennemie des virtualistes, qu’ils soient russes hier ou américains aujourd’hui ; chacun son tour. La colonel Poutine est un véritable real politiker, les Russes ont bien de la chance, et peut-être le monde aussi. L’élégant président Armani Nedjad sourit dans sa barbe. |
|
Propos d’un avorton virtualiste « Prenons ce
que Voyer considère comme sa grande découverte “scientifique” :
l’inexistence de l’économie. Au début, il s’agissait de dénoncer l’économie
comme une idéologie ; ce qui était tout à fait pertinent. Pour ce faire,
il suffisait de montrer l’économie pour ce qu’elle est en réalité : une
vision utilitariste et intéressée du monde qui essaie de se faire passer pour
vue objective et scientifique. Il se trouve qu’à
l’époque où Voyer développe brillamment cette thèse l’universitaire Louis
Dumont publiait un livre où il expose la même. » (Cap’tain Nullus,
in « Une imposture intellectuelle » on: 16. December 2005 at 07:45) Cité par
Mister Toto le 25 avril 2006 « Au
début, il s’agissait de dénoncer l’économie [la science économique] comme une
idéologie ; ce qui était tout à fait pertinent. » Ce début n’eut pas lieu
dans ma vie et ne fut pas de mon fait puisque Engels en 1840, avant même que
Marx n’eût lu la moindre ligne d’économie politique, fit très bien cette dénonciation.
Ensuite, jamais je n’eus pour but de « montrer l’économie pour ce qu’elle est en réalité : une vision
utilitariste et intéressée du monde qui essaie de se faire passer pour vue
objective et scientifique. »
mais bien de montrer que l’économie [la réalité économique] n’existe pas, de
montrer ce que l’économie est en réalité, c’est à dire rien. Dès 1962, lors
de la première lecture du capital, je ne fus pas choqué par l’aspect
utilitariste de l’économie politique mais par la prétention de Marx à faire
de l’économie — prétendument une partie de la société — ce qui détermine en
dernière instance tout ce qui se passe dans la société et l’histoire de cette
société. La conclusion qui s’imposa à moi fut que l’économie ne pouvait pas
déterminer en dernière instance tout ce qui se passe dans la société et dans
l’histoire de cette société pour la bonne et simple raison que l’économie
n’existe pas. Je n’ai donc jamais développé brillamment la thèse dont parle
l’avorton. Cet avorton est aussi un imbécile (un petit imbécile), ce qui
n’est pas nouveau. Le Debordel est un repaire d’imbéciles. (A propos
d’imbéciles : vous remarquerez que lorsque je réponds publiquement à un
auteur, je prends soin de citer le texte. Cela laisse donc toute liberté à
cet auteur de modifier son texte autant qu’il le voudra sans pour autant
changer la teneur de mes propos. Qu’est-ce qu’il y a comme petits cons
quand-même. Quelle pullulation.) Conclusion : la thèse qu’expose Dumont n’est pas la même et croyez bien que je le regrette. Il a fallu que j’attende vingt ans pour trouver des auteurs qui soutinssent la même thèse. Aujourd’hui je ne suis plus seul. Je connais au moins cinq auteurs qui sont sur les mêmes positions, l’un d’eux (Fourquet) totidem verbis : « cet objet n’existe pas. Ce qui existe, c’est un discours économique qui fabrique ses propres objets et qui finit par croire à l’existence extérieure de ces êtres fantastiques qu’il a lui-même engendrés » ou encore « L’illusion de l’existence objective d’une structure sociale appelée “économie de la société” est si puissante que Marx en fit la base de la société et inventa une contradiction tout aussi illusoire entre cette base imaginaire et une prétendue superstructure politique » et encore : « Cette manière de penser transforme un classement, dont l’intellect a besoin pour démêler l’écheveau des relations empiriques, en une structure-substance historique pourvue d’une efficacité causale quasi divine. » (« idéologie délirante » n’est-ce pas, sans doute le fait d’un dément doublé d’un fanatique furieux. Amaïh Pleksy-Gladz !) — sans oublier celle-ci, de Polanyi (encore un dément), qui est bien bonne —. De plus c’est un spécialiste de comptabilité nationale (un surintendant) et des physiocrates. Il a travaillé vingt cinq ans sur la question. Remarquable travail. C’est un inappréciable bonheur de lire un économiste qui écrit froidement que l’économie n’existe pas, qu’existe un discours économique, mais que n’existe pas d’objet économique de ce discours (cependant, ce discours a un objet, je n’aborderais pas cette question ici). Je n’aurais jamais attendu ça d’un économiste, qui pourtant est le plus qualifié pour le dire et qui nous donne un livre parfaitement étoffé, ce que je suis incapable de faire. On the road, c’est difficile en effet. Pour une fois mes impôts furent bien employés. D’autre part, l’économie qu’il s’agissait de dénoncer comme une idéologie (en 1840) est l’économie politique devenue depuis science économique ou doctrine économique. Or jamais je ne me suis soucié de prouver quoi que ce soit à propos de l’économie politique, ni de la science économique. Je me suis contenté de rapporter ce que d’autres que moi avaient déjà dit de cette idéologie, Marx et Engels, les anthropologues et ethnographes, Weber, bien mieux que je n’aurais pu le faire moi-même et cela afin d’étayer ma thèse qui est que l’économie n’existe pas. L’économie dont j’ai fait l’objet de ma recherche et dont j’affirme qu’elle n’existe pas n’est pas l’économie politique (economics) mais la réalité économique (economy). C’est également cette économie-là dont Marx prétendait qu’elle était une partie de la société, qui plus est déterminante. Cet avorton est un crétin (un petit crétin). Ce que je considère comme ma grande découverte, en 1975, après treize ans d’effort, n’est pas l’inexistence de l’économie mais que « La valeur est un échange effectué en pensée ». J’ai résolu — en comprenant, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, la grammaire du mot valeur, grammaire qui n’a jamais posé de problème dans l’usage, à travers les millénaires, mais seulement dans la… métaphysique — une question qui tourmentait déjà Aristote (ce qui fit dire, en 1976, à Pierre Balthazar de Muralt, patron et fondateur des éditions Rencontre qui permirent à Popu de lire Balzac en entier — 2.200 employés — que j’étais le nouvel Aristote. Un ancêtre de cet homme est l’inventeur de l’Ovomuraltine). L’inexistence de l’économie en découle. La grandeur de la découverte « L’économie n’existe pas » n’est pas de mon fait mais de celui de la résistance acharnée et furibonde qu’elle occasionna. C’est cette résistance qui est grande même si elle compte des avortons dans ses rangs. Pour ma part, je n’ai consacré à cette découverte que deux lignes dans mon livre de 1976. Pour moi, elle allait dorénavant de soi. Je fus le premier surpris de la résistance qu’elle provoqua. C’est d’ailleurs ce qui me permit de découvrir l’importance de ce que des milliers de petits cons nomment mon idéologie délirante. Résumé : il ne s’est jamais agi pour moi de démontrer que l’économie politique était une idéologie. Cela Engels et Marx l’avaient déjà fait très bien au point qu’on emploie couramment aujourd’hui l’expression « une idéologie au sens de Marx ». Au contraire, c’est parce que j’ai découvert que l’économie n’existait pas que, de ce fait, existe une raison supplémentaire (donc suffisante mais non nécessaire), nullement envisagée par Marx, pour que l’économie politique soit une idéologie. La cécité de Marx sur ce point implique qu’il fut la première victime de l’idéologie qu’il dénonçait. Et je n’ai stigmatisé l’utilitarisme de cette idéologie que pour stigmatiser celui de Marx et celui de la résistance acharnée et furibonde qu’occasionna ma découverte dans les circonstance que l’on connaît. Ce qui a lieu d’abord, c’est la découverte que l’économie n’existe pas (1976). Ce qui vient ensuite, c’est la stigmatisation de l’utilitarisme de l’économie politique (après 1979). Ce n’est pas l’économie politique que j’attaque, c’est l’utilitarisme, où qu’il soit (il est partout comme le célèbre journal collabo). Au début (1962), il s’agissait pour moi de critiquer la prétention fantastique de Marx à vouloir expliquer la société par une partie de la société (ce qui rappelle, mutatis mutandis, la projet de Hilbert pour fonder les mathématiques par une partie des mathématiques) et nullement de prouver quoi que ce soit concernant l’économie politique : « Ce qu’il y a de plus grossièrement faux dans la théorie de Marx consiste dans sa prétendue critique de l’économie [politique] où il ne cesse de maintenir, sous couvert de critique, le point de vue même de l’économie [politique]. » (Rapport sur l’état des illusions, p. 45, 1979). Quel est ce point de vue de l’économie politique ? Que l’économie (economy) existe, évidemment. Et pourquoi ? Parce que c’est l’objet qu’elle étudie, preuve indiscutable (virtualisme) de son existence (superintendant Fourquet encore : « À la limite, pour définir la science économique, il suffira de dire qu’elle est la science de l’économie, et le tour sera joué. La tautologie paraît grossière, elle confine à la supercherie, mais Say ne fait pas autrement quand il dit “l’économie politique est la simple exposition des lois qui président à l’économie”. »). C’est le fait que l’économie politique croie à l’existence d’une réalité économique (Marx a porté cette croyance jusqu’à l’adoration) qui implique qu’elle est une idéologie utilitariste. Donc : c’est ma découverte de l’inexistence d’une réalité économique qui met en pleine lumière cet utilitarisme et non l’inverse. |
« L’esprit doit être placé
dehors, dans les échanges entre personnes,
plutôt que dedans, dans un flux interne de représentations »
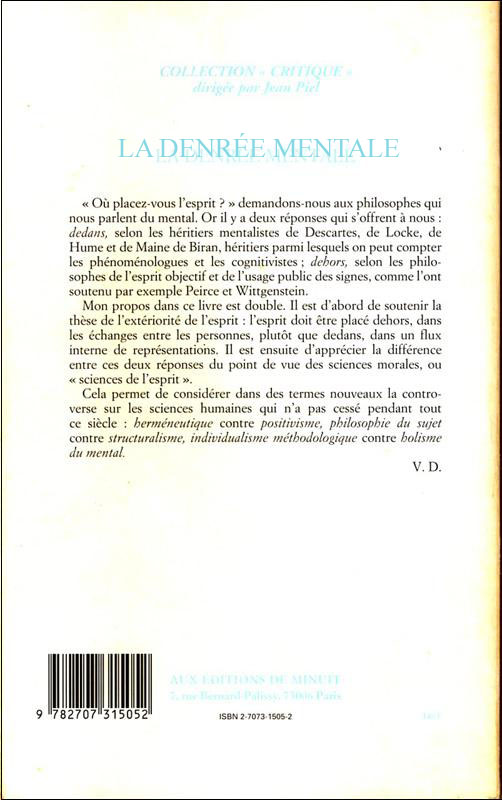
|
« La nature, c’est l’existence
des choses,
en tant qu’elle est déterminée selon des lois universelles. [ Cette
nature là est donc un fait et non une chose, et encore moins les
choses en elles-mêmes : c’est un fait que l’existence des
choses est déterminée selon des lois. Kant nomme ce fait nature ;
tandis que les crétins nomment « nature » une chose qui
n’est aucune chose, ce que Kant, ailleurs, nomme apparence
transcendantale et ce que Hegel nommerait une chose qu’il faut bien
appeler mauvaise puisqu’elle n’est aucune chose ] Si la
nature devait désigner l’existence des choses en elles-mêmes, nous ne pourrions jamais la connaître, ni a priori, ni a posteriori. A priori, ce
serait impossible, car comment
savoir ce qui revient aux choses en elles-mêmes ? Cela ne saurait se faire par décomposition de nos
concepts (propositions analytiques), car
ce que je veux savoir, ce n’est pas
ce qui est contenu dans mon concept d’une chose (car c’est à son être
logique que cela appartient), mais bien ce qui s’ajoute à ce concept dans la réalité de la chose, et ce
qui permet à la chose d’être déterminée dans son existence en dehors
de mon concept. Mon entendement, avec les
conditions qui lui sont indispensables pour lier les déterminations des choses
en leur existence, ne prescrit aucune règle aux choses en
elles-mêmes ; ce n’est pas elles qui se règlent sur mon entendement,
c’est mon entendement qui devrait se régler
sur elles ; il faudrait donc
qu’elles me soient préalablement
données pour que j’en puisse tirer ces déterminations ; mais en ce cas, on ne les connaîtrait pas a priori. » « Le mot : nature prend encore un autre sens, celui qui détermine l’objet, alors que le sens précédent signifiait seulement que les déterminations de l’existence des choses en général sont conformes à des lois. Donc la nature, considérée materialiter, c’est l’ensemble [ Inbegriff. Bolzano l’emploie au sens de collection, ensemble. Kant considère, au second sens, la nature comme une classe et non comme une chose. Oui, la nature est bien un objet ; mais non, la nature n’est pas une chose. Les crétins considèrent la nature comme une chose. Les crétins croient tout ce qu’on leur dit de croire. La soumission rend con. La désobéissance aussi, hélas. ] de tous les objets de l’expérience. C’est uniquement à celle-ci que nous avons affaire ; car autrement, pour connaître en leur nature des choses qui ne pourraient jamais devenir objet d’une expérience, il nous faudrait recourir à des concepts dont la signification ne pourrait jamais être donnée in concreto (dans quelque exemple d’une expérience possible) ; nous en serions donc réduits à forger, sur la nature de ces choses, des concepts tels que nous serions tout à fait incapables de décider de leur réalité, de dire s’ils se rapportent réellement à des objets ou s’ils n’ont d’autre existence que mentale [ Gedankendinge : chose pensée ce qui est assez différent de « pure existence mentale ». Je n’ai toujours pas compris ce que pouvait être une chose mentale. Kant dit plus loin qu’est objectif ce qui est universel, je dirais : ce qui est commun. C’est le cas du nombre trois. Ainsi le nombre trois, qui a, à titre d’objet commun, une pleine objectivité mondiale et… éternelle, ne serait qu’existence mentale ]. De ce qui ne peut être un objet de l’expérience, la connaissance serait hyperphysique ; ce n’est nullement à une connaissance de ce genre que nous avons affaire ici, mais bien à la connaissance de la nature, dont la réalité peut être confirmée par l’expérience, encore qu’elle soit possible a priori et qu’elle précède toute expérience. » |
« MANIFESTE POUR LA VRAIE
DÉMOCRATIE »
|
La ménagerie à Locke à Loches. Allo Loches !