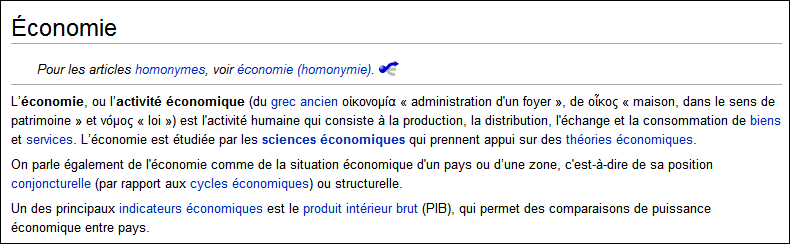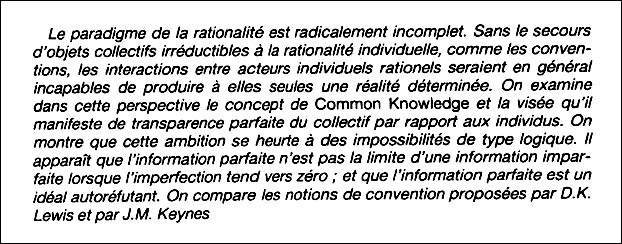NOTES 5
Pour imprimer réduire à
85 %
Les individus collectifs
(1992) – Descombes
L’utilitarisme comme
représentation sociale du lien humain – Christian Laval
Pourquoi New York fut
bombardée
Exemples de ces évaluations
moyennes qui deviennent une expression idéale des valeurs
Duhem : une théorie
physique n’est pas une explication
C’est oukounoumique
La barbe de Platon émousse régulièrement le fil du rasoir d’Occam – Quine
L’économie n’est pas une
institution
Grandir ensemble
Deux conceptions du monde
(de defensa)
La valeur propose, l’argent
dispose
Le coup d’État feutré –
Simon Johnson at Jorion’s
L’économie comme illusion
– Timothy Mitchell
Capitalisme suicidaire
– William Pffaff
La main invisible dévoilée
– Paul Jorion
Une définition absurde
Indiscipline répond à Bruno Latour le trop
discipliné
Convention et Common
Knowledge – Jean-Pierre Dupuy
Mary Douglas : comment
les institutions font les classifications
La rationalité est la même,
mais les institutions diffèrent
Critère d’Aristote
|
« La philosophie
d’aujourd’hui a-t-elle le moyen Pour les
collectivités : NON Cet article de trente deux pages, limpide, didactique et enthousiasmant expose mieux que je ne saurais le faire, les raisons pour lesquelles l’économie n’est pas un objet réel, c’est-à-dire n’est pas une partie du monde comme on essaye de nous le faire croire, à chaque instant dans le poste. Il expose comment il peut y avoir des faits économiques sans qu’il y ait pour autant « une économie » (ce n’est plus la peine de me demander pour la nième fois comment pourrait-il ne pas y avoir d’économie puisqu’il y a des faits économiques. Je ne répondrai plus). C’est une simple question de logique. C’est la logique qui résout cette question. La relation d’appartenance n’est pas transitive : ce n’est pas parce que 1) les chiens appartiennent à l’ensemble des chiens et que 2) l’ensemble des chiens appartient à l’ensemble des non-chiens (puisqu’il n’est pas un chien) que 3) les chiens appartiennent à l’ensemble des non-chiens. Les patatoïdes d’Euler sont merdiques car ils incitent à confondre relation d’inclusion, qui est transitive, et relation d’appartenance, qui ne l’est pas (c’est quelqu’un comme Hilbert ? ou Russell ? qui a dit ça et c’est bien vrai).
|
|
● L’utilitarisme comme
représentation sociale du lien humain (Christian Laval)
|
|
|
|
|
● Pourquoi
New York fut bombardée : « elle se tenait bien raide,
là, pas baisante du tout, raide à faire peur » (de defensa)
[…][tvj44h3xbuaz]
* * *
|
|
|
/46/ Touchant la nature même des choses, touchant les réalités qui se cachent sous les phénomènes dont nous faisons l’étude, une théorie conçue sur le plan qui vient d’être tracé ne nous apprend absolument rien et ne prétend rien nous apprendre. (…) L’aisance
avec laquelle chaque loi expérimentale trouve sa place dans la
classification créée par le physicien, la clarté éblouissante qui se répand
sur cet ensemble si parfaitement ordonné, nous persuadent d’une manière
invincible qu’une telle classification n’est pas purement artificielle, qu’un
tel ordre ne résulte pas d’un groupement purement arbitraire imposé aux
lois par un organisateur ingénieux. Sans pouvoir rendre compte de notre
conviction, mais aussi sans pouvoir nous en dégager, nous voyons dans
l’exacte ordonnance de ce système la marque à laquelle se reconnaît une
classification naturelle : sans prétendre expliquer la réalité qui se
cache sous les phénomènes dont nous groupons les lois, nous sentons que les
groupements établis par notre théorie correspondent à des affinités réelles
entre les choses mêmes. Le physicien, qui voit en
toute théorie une explication, est convaincu qu’il a saisi dans la
vibration lumineuse le fond propre et intime de la qualité que nos sens
nous manifestent sous forme de lumière et de couleur : il croit à un
corps, l’éther, dont les diverses parties sont animées, par cette
vibration, d’un rapide mouvement de va-et-vient. Certes, nous
ne partageons pas ces illusions. Lorsqu’au cours d’une théorie optique,
nous parlons encore de vibration lumineuse, nous ne songeons plus à un
véritable mouvement de va-et-vient d’un corps réel ; nous imaginons
seulement une grandeur abstraite, une pure expression géométrique dont la
longueur, périodiquement variable, nous sert à énoncer les hypothèses de
l’Optique, à retrouver, par des calculs réguliers, les lois expérimentales
qui régissent la lumière. Cette vibration est pour nous une représentation et
non pas une explication. Mais lorsque
après de longs tâtonnements, nous sommes parvenus à formuler, à l’aide de
cette vibration, un corps d’hypothèses /53/ fondamentales ;
lorsque nous voyons, sur le plan tracé par ces hypothèses, l’immense
domaine de l’Optique, jusque-là si touffu et si confus, s’ordonner et
s’organiser, il nous est impossible de croire que cet ordre et que cette
organisation ne soient pas l’image d’un ordre et d’une organisation
réels : que les phénomènes qui se trouvent, par la théorie, rapprochés
les uns des autres, comme les franges d’interférence et les colorations des
lames minces, ne soient pas en vérité des manifestations peu différentes
d’un même attribut de la lumière ; que les phénomènes séparés par la
théorie, comme les spectres de diffraction et les spectres de dispersion,
n’aient pas des raisons d’être essentiellement différentes. Ainsi, la
théorie physique ne nous donne jamais l’explication des lois
expérimentales ; jamais elle ne nous découvre les réalités qui se
cachent derrière les apparences sensibles : mais plus elle se
perfectionne, plus nous pressentons que l’ordre logique dans lequel elle
range les lois expérimentales est le reflet d’un ordre ontologique : plus
nous soupçonnons que les rapports qu’elle établit entre les données de
l’observation correspondent à des rapports entre les choses [Cf. Poincaré, La Science et l’Hypothèse, Hermann, 1903,
p. 190] ; plus nous devinons
qu’elle tend à être une classification naturelle. De cette
conviction, le physicien ne saurait rendre compte : la méthode dont il
dispose est bornée aux données de l’observation ; elle ne saurait donc
prouver que l’ordre établi entre les lois expérimentales reflète un ordre
transcendant à l’expérience : à plus forte raison ne saurait-elle
soupçonner la nature des rapports réels auxquels correspondent les
relations établies par la théorie. Mais cette
conviction, que le physicien est impuissant à justifier, il est non moins
impuissant à y soustraire sa raison. Il a beau se pénétrer de cette idée que ses théories
n’ont aucun pouvoir pour saisir la réalité, qu’elles servent uniquement à
donner des lois expérimentales une représentation résumée et classée :
il ne peut se forcer à croire qu’un système capable d’ordonner si
simplement et /54/ si aisément un nombre immense de lois, de prime abord si
disparates, soit un système purement artificiel ; par une intuition où
Pascal eût reconnu une de ces raisons du cœur « que la raison ne
connaît pas », il affirme sa foi en un ordre réel dont ses théories
sont une image,
de jour en jour plus claire et plus fidèle. Ainsi l’analyse des méthodes par lesquelles
s’édifient les théories physiques nous prouve, avec une entière évidence,
que ces théories ne
sauraient se poser en explication des lois expérimentales ; et,
d’autre part, un acte de foi que cette analyse est incapable de justifier,
comme elle est impuissante à le refréner, nous assure que ces théories ne
sont pas un système purement artificiel, mais une classification naturelle. Et l’on peut,
ici, appliquer cette profonde pensée de Pascal : « Nous avons une
impuissance de prouver invincible à tout le Dogmatisme ; nous avons
une idée de la vérité invincible à tout le Pyrrhonisme ». [Pierre Duhem, La Théorie physique, Vrin] |
J’avais quelque peine à répondre à Searle sur ce point. Duhem le fait très bien. Dans la théorie, seule la classification est naturelle et non pas les reflets, les images, les représentations, très provisoires.
|
|
|
|
Il semble alors, si ce raisonnement est juste, que dans toute
dispute ontologique, le partisan du rejet souffre du désavantage de ne pas
être capable d’admettre que son
opposant est en désaccord avec lui. C’est la vieille énigme
platonicienne du non-être. Le non-être doit, en un certain sens, être, car
sinon qu’est-ce qu’il y a qu’il n’y a pas ? Cette doctrine embrouillée pourrait
être surnommée la barbe de Platon: historiquement, elle a fait la preuve de sa
résistance en émoussant régulièrement le fil du rasoir d’Occam. C’est une façon de penser
comparable qui conduit les philosophes comme McX à accorder l’être là où
ils pourraient tout à fait se contenter de reconnaître qu’il n’y a rien.
Ainsi, prenons Lékounoumie ♦. Si Lékounoumie n’était pas, selon l’argument de
McX, il n’y aurait rien dont nous fussions en train de parler lorsque nous
utilisons ce mot, ce serait par conséquent un non-sens de dire même que Lékounoumie n’est pas ♦♦. McX, pensant avoir
ainsi montré que l’exclusion de Lékounoumie ne peut être maintenue
de façon cohérente, en conclut que Lékounoumie
est [c’est l’argument que m’opposait le crétin qui
signait Occam ou Spinoza sur le Debord off]. Certes, McX ne peut vraiment se persuader qu’une quelconque région de l’espace-temps, proche ou lointaine, contient une lékounoumie, de chair et de sang. Pressé de donner plus de détails sur Lékounoumie, il dit alors que Lékounoumie est une idée dans l’esprit des hommes. Ici, cependant, point une confusion. Nous pouvons, pour les besoins de l’argument, concéder qu’il y a une entité, et même une entité unique (bien que cela soit assez peu vraisemblable), qui est l’idée-de-Lékounoumie, entité mentale, mais cette entité mentale n’est pas ce dont Voyer parle lorsqu’il exclut Lékounoumie ♦♦♦. McX ne confond jamais le Parthénon avec l’idée-du-Parthénon.
Le Parthénon est physique. L’idée-du-Parthénon est mentale (du moins, selon
la version que propose McX des idées, et je n’ai rien de mieux à offrir [et Frege, alors ?]). Le Parthénon est
visible, l’idée-du-Parthénon est invisible. Nous ne pouvons guère imaginer
deux choses plus dissemblables, et moins susceptibles d’être confondues,
que le Parthénon et l’idée-du-Parthénon. Mais quand nous passons du
Parthénon à Lékounoumie, la
confusion s’installe pour la simple raison que McX se laisserait abuser par
la plus grossière et la plus flagrante des contrefaçons ♦♦♦♦
plutôt que d’accepter le non-être de Lékounoumie.
[d’après Willard Couine : De ce qui est]
|
|
Ceux qui me demandent, en supposant qu’il soit prouvé que l’économie n’est pas, : « À quoi ça sert de savoir que l’économie n’est pas ? » me posent, à leur insu, une toute autre question. Ils me demandent, en fait, « À quoi ça sert de comprendre ce que l’on dit ? » Ainsi, quand ils disent : « L’économie va mal », ils disent en fait : « La classe des faits économiques va mal », ce qui est une absurdité, parce qu’une classe ne peut pas aller bien ou mal, une classe ne peut pas être rouge ou verte etc. Je suis bien conscient que ce n’est pas cela qu’ils veulent dire, qu’ils ne font pas exprès de dire des absurdités ; mais dans ce cas, si ce n’est pas ce qu’ils veulent dire, il faut qu’ils disent autrement ce qu’ils veulent dire car, présentement, ils disent une absurdité. Mais savent-ils ce qu’ils veulent dire ? Oui, je vous le demande, à quoi peut bien servir de comprendre ce que l’on dit ? Meuh ! |
|
● Deux conceptions du monde (de defensa) […][kf7nbaz57jfu]
|
|
● La valeur propose, l’argent dispose
|
|
Le coup d’État feutré, par Simon Johnson at
Jorion’s →
|
L’économie comme illusion par Timothy
Mitchell →
|
● Capitalisme suicidaire par William Pffaff […][4r69fsmnbepg]
|
|
● La main invisible dévoilée par Paul Jorion
|
|
Il n’existe pas d’« activité humaine qui consiste à la production, la distribution, l’échange et la consommation des biens et des services. » Il existe des activités économiques, c’est à dire des activités classées « économiques » (par l’INSEE par exemple), qui appartiennent donc à la classe « activités économiques ». Il s’agit de statistique. L’activité qui opère ce classement est la statistique. Il existe bien une activité humaine, que l’on peut facilement identifier, qui est la statistique et dont un des moments consiste à classer. Un des buts de la statistique est de fournir la situation économique des pays, situation qui est représentée par des nombres. On peut l’appeler par abréviation l’économie d’un pays, économie qui va bien ou mal selon que les nombres sont bons ou mauvais. En fait, c’est le pays qui va bien ou mal. Mais cette économie n’est aucune action, aucune activité, qu’elle soit individuelle ou collective. Elle est seulement un tableau de nombres dits encore indicateurs. C’est le crétin Say qui, en 1818, a décidé, quelle trouvaille, que la science économique étudiait l’économie. D’ailleurs, les sciences économiques étudient, la plupart du temps, du vent ; l’équilibre de Nash, par exemple. |
|
● Indiscipline répond à Bruno Latour le trop discipliné ● UNE POLITIQUE DE LA NATURE SANS POLITIQUE À propos de Politiques de la nature de Bruno Latour, par Alain Caillé. Revue du MAUSS n° 17. ● Réponse de Latour : Revue du MAUSS n° 17 Commençant ma lecture, j’ai l’impression que ces non-humains ne sont autre que le pratico-inerte de Sartre, la matière ouvrée qui permet la réciprocité des « agents » (quand je lis le mot agent, je sors mon revolver) sous le regard du tiers unificateur (Sartre est un individualiste méthodologique enragé. Ce fameux tiers, c’est la totalité, c’est le tout et non pas un homme, pas plus que le Pirée). Si tel est le cas, le terme est mal choisi car la matière ouvrée est humaine, trop humaine d’ailleurs. Quand dans le silence de ma berline six cylindres de deux cent chevaux, je roule lentement sur une route sinueuse et déserte dans la campagne non moins déserte, je suis parfois saisi de terreur à l’idée du labeur, de l’activité, de l’agitation qu’a coûté ce calme paysage et je me dis : « non, rien, jamais, ne changera » tant l’inertie du pratico-inerte me saisit à la gorge. Je m’empresse alors de penser à autre chose. Saviez vous que les courbes des chaussées ne sont pas
des arcs de cercle mais commencent et finissent par des clothoïdes, courbes à
rayon progressivement décroissant de l’infini au rayon de l’arc de cercle du
milieu de virage, ceci afin d’éviter que les automobilistes ne
|
[b] Convention
et Common Knowledge Jean-Pierre Dupuy, 1989 →
[b] Le
modèle d’Adam Smith Jean-Pierre Dupuy →
|
|
Je vous l’avais bien dit, les hommes vivent dans un savoir. Si les institutions sont différentes, le savoir est différent, mais… la rationalité est la même — et en aucun cas elle n’est la prétendue rationalité de l’individualisme méthodologique. Weber le dit bien, n’est-ce pas ? pour s’empresser de faire immédiatement le contraire. Voulez-vous donc que je vous inflige une nouvelle fois l’histoire que racontait le maire de mon village (c’est là, pour ceux qui ne la connaissent pas) afin que vous puissiez admirer cette prétendue rationalité dans toute sa splendeur ? → L’article très intéressant qui m’a mis sur la voie de Mary Douglas : L’économie des conventions est-elle hétérodoxe ? Nicolas Postel. DOC 2009-01-26 Construire du social et construire du savoir
deviennent une seule et même opération
|
|
|
|
Je lis L’Inconscient malgré lui (1977) de Descombes. J’y lis (« 12. La sophistique ») : « Nous disons être ce qui paraît à tous, déclare Aristote » Ainsi donc Aristote est aussi le précurseur de la théorie des situations (de quoi Aristote n’est-il pas le précurseur). La connaissance de la situation est l’élément essentiel, constitutif, de la situation (pas de connaissance de la situation, pas de situation) : la situation consiste dans la connaissance de la situation, dirai-je pour parodier Frege. Pour pouvoir dire que « être est ce qui paraît à tous », il faut que nous sachions ce qui paraît à tous, et de fait, nous le savons (hélas, non ; nous croyons le savoir). Nous voilà bien loin de la sempiternelle controverse avec Berkeley et « Esse est percipi aut percipere" (« Être c’est être perçu ou percevoir ». D’abord, percevoir c’est exister et non pas être (d’où l’existentialisme enfin bien compris). Ensuite, être, c’est paraître à tous et non pas à soi. Le moi est haïssable. Le moi est un trou-du-cul. Merde à Berkeley. Merde à Locke. Merde à Vauban. Gloire à Aristote. À juste titre, Hume dit contre Descartes que rien n’existe (la philosophie consiste à dire ce qui n’est pas, donc bravo Hume) qui serait le moi, le moi étant le sujet que l’on pourrait regarder. Mais il a tort contre Sartre, le moi existe bien, mais le moi n’est pas le sujet que l’on pourrait regarder. Le moi est un objet comme un autre. C’est la communication générale, c’est le monde, qui décident de ce qui est et de ce qui n’est pas, à tort ou à raison. Ainsi, beaucoup de c… croient que la Production, la Consommation, l’Économie existent. Moi non : la production ne produit rien, la distribution ne distribue rien, la consommation ne consomme rien et, évidemment, l’économie n’économise rien. La philosophie, c’est dire ce qui n’est pas quoiqu’en dise chacun. C’est dire quelles sont les croyances non fondées et pourquoi. Pourquoi la croyance en l’existence de l’économie est une croyance non fondée ? Parce qu’un ensemble ne peut pas être une partie du monde. Mais beaucoup plus simplement parce que personne n’a jamais vu l’économie, et que donc, l’économie n’ayant jamais paru à personne, elle ne saurait paraître à tous : il s’agit d’une illusion collective (chacun ne l’a jamais vue, mais il croit que tous les autres l’ont vue puisqu’ils en parlent avec une mâle assurance), les ânes s’encouragent à braire les uns les autres. Si la connaissance de la situation est juste (chacun sait que tous croient à l’existence de l’économie), la situation, elle, est fausse (car, quoique n’ayant jamais vu l’économie, il croit à tort que les autres l’ont vue). Ce qui ferait que l’économie existe, ce n’est pas que tous croient à son existence, mais que tous l’aient vue et que chacun sache que tous l’ont vue effectivement. L’économie échoue au critère d’Aristote. Le monde (la tradition dirait Lévi-Strauss) ne saurait se tromper. Meuh ! Être, ne résulte pas de « savoir que tous croient », mais de « savoir que tous savent ». La confusion provient de ce que « chacun croit savoir que chacun sait » (vicious circle) alors que « chacun croit et ne sait pas », seulement. Nous en reparlerons. Il faudrait que « chacun sache que chacun croit savoir alors qu’il croit qu’il sait ». Évident. Le monde est donc un savoir, c’est ce savoir qui décide de ce qui est et de ce qui n’est pas. Il n’y a nul arbitraire là-dedans. Je ne trouve pas le passage Éthique à Nicomaque, X, 2, 1173 a 1, dans la traduction Tricot et je n’ai pas la traduction G & J. Ce n’est que partie remise. Je suis bien conscient que « paraît » peut indifféremment signifier « semble » (apparence au sens d’éléphants roses) ou « apparaître ». Pour les besoins de ma cause je dirai donc « Nous disons être ce qui apparaît à tous » ; c’est ainsi que j’ai compris la phrase et que ça a fait tilt ! une fois de plus. Comme d’habitude, ce qu’a dit effectivement Aristote m’importe peu. Je ne cherche pas, je trouve. |